Les multiples parcours de la langue arabe
DOSSIER
Les multiples parcours de la langue arabe
Orient XXI publiera un article par jour durant la semaine du 28 octobre au 2 novembre.
Quel regard peut-on porter aujourd’hui sur cette langue ancienne de la famille sémitique, attestée dès le début de l’ère chrétienne? Langue de la poésie considérée comme un art majeur dans l’Arabie pré-islamique? Langue du Coran dont le texte sacré a fixé les règles de grammaire et amorcé une présence planétaire? Langue de l’administration, héritée de l’empire omeyyade né en Syrie, ou plutôt héritage glorieux de l’empire abbasside qui en a fait un vecteur de science et de philosophie, parallèlement à la littérature raffinée de «l’honnête homme» et celle du «miroir des princes»? Demeure-t-elle objet de nostalgie pour le rôle de «passeur de culture» vers l’Europe qu’elle a pu jouer en Andalousie? Est-ce avant tout la langue de la presse du Proche-Orient, modernisée par la Nahda? Ou l’arme démagogique d’une arabisation à marche forcée dans les pays du Maghreb, dont le fond démographique est historiquement berbère? Est-ce tout bonnement l’une des langues les plus présentes sur Internet? Est-ce enfin une langue caractérisée — plus que d’autres — par sa diglossie, c’est-à-dire un dédoublement entre une variété dite haute, l’arabe officiel, dit «littéral», ou «standard», commun à tous, et la variété basse, celle des divers idiomes parlés au quotidien dans chaque pays arabe? Est-elle simplement un outil de communication comme un autre dont peuvent se saisir des Français en Europe ou des immigrés asiatiques et africains dans les pays arabes?
Les articles qui suivent apportent des regards multiples, parfois contradictoires, sur une réalité foisonnante. Le débat n’en est que plus intéressant.
➞ La vidéo de Lamine Lassoued (Nawaat) évoque la légitimité de la langue parlée au quotidien en matière de production et de transmission du savoir, par rapport à la langue arabe écrite, officielle, dite savante. Cet idiome est présenté comme une langue à part entière, qualifiée d’«arabe tunisien», qui mériterait de recueillir la traduction d’œuvres étrangères. Elle serait la langue du peuple face à celle de l’élite, voire un marqueur de la lutte des classes. L’arabe littéral ne serait pas le seul réceptacle du patrimoine écrit; la langue des archives tunisiennes regorgerait elle-même de termes du «parler tunisien». Un seul intervenant parmi les cinq personnes interrogées estime que la langue arabe est le lien qui rattache la Tunisie aux pays arabes. La rejeter signifierait se couper de son environnement, comme du patrimoine commun. Pour lui, les partisans du «tout-dialecte» portent une idéologie qui est loin d’être innocente.
➞ «Nous sommes libres de nous exprimer en algérien» de Nabil Mansouri, de Maghreb Émergent va dans le même sens que le précédent, à savoir celui d’une valorisation de la langue parlée, tout en portant à l’extrême l’antagonisme avec la langue officielle. L’idiome algérien est ainsi investi du rôle d’expression de la «voix du peuple», par opposition à une langue qui serait celle du pouvoir, symbolisant l’oppression et la répression.
L’auteur s’appuie dans sa démonstration sur un incident survenu lors d’une manifestation populaire en Algérie où le manifestant interrogé par une journaliste d’une chaîne arabophone, Sky News Arabia, lance un slogan que la journaliste probablement levantine ne comprend pas : «Yetnahaw Gâa». Le manifestant se révolte contre l’exigence de la journaliste de parler plus clairement, «en arabe». L’expression a fait le buzz, et sa popularité est consacrée par une entrée dans Wikipedia. Dans un pays aux multiples facettes linguistiques, dont l’amazigh, le français, langue de l’imposant héritage de l’ère coloniale, et l’arabe, renforcé par la politique d’arabisation, le seul dénominateur commun, selon l’auteur, est l’idiome algérien, qui devrait retrouver ses lettres de noblesse, notamment dans l’enseignement.
➞ L’article de Chaker Jarrar, de 7iber, sur les différents accents de l’idiome jordanien montre que les choses sont souvent beaucoup plus complexes qu’il n’y paraît, et qu’une telle assignation du dialecte au rôle de «rebelle» populaire pourrait être illusoire. Son texte est une étude très fouillée, nourrie d’anecdotes savoureuses, des usages multiples d’un même dialecte. Son caractère sérieux n’empêche nullement une lecture agréable de ce que l’on pourrait intituler «tribulations d’un phonème devenu phénomène!» car il nous montre comment, selon l’ origine géographique d’une personne, son appartenance à une classe sociale, à la ruralité ou à la ville, au genre féminin ou masculin, à son choix de société, traditionnelle ou moderne, voire sa posture idéologique… ou même selon l’interlocuteur auquel elle s’adresse, le même mot sera prononcé différemment, avec d’importantes implications sociales.
L’intérêt de l’article ne s’arrête pas à l’étude sociolinguistique, très riche au demeurant. Il nous offre en même temps une sorte de panorama historique et géographique de la Jordanie.
➞ «Quand les travailleuses domestiques s’approprient les mots des maîtres» de Micheline Tobia (Mashallah News) nous rappelle à juste titre qu’un idiome peut être à la fois l’instrument d’une oppression et celui d’une libération, selon qu’il est utilisé par les maîtres, qui ont recours aux «insultes, ordres ou autres formes de violence verbale», ou qu’il est réinvesti par leurs domestiques dans le combat social qu’elles mènent pour la protection de leurs droits. L’apprentissage de l’idiome libanais représente une question de survie pour les Éthiopiennes, Sri-lankaises, ou Malgaches qui arrivent sur le marché du travail immigré. Parler l’idiome leur est d’abord imposé, pour pouvoir communiquer avec les maîtres. Il exprime ensuite un besoin de communiquer entre elles, en raison de leurs appartenances diverses, parfois au sein d’un même pays, comme Maya, qui nous rappelle l’existence de plus de 80 dialectes en Éthiopie. Besoin également de se défendre dans la rue contre le harcèlement. D’être autonome dans leurs déplacements. Voire de mieux faire parvenir aux médias leurs slogans dans les marches de protestations.
De même que la fonction du dialecte dépend de celui qui l’utilise, l’arabe littéral peut à son tour être utilisé par le pouvoir politique pour renforcer son emprise sur le peuple.
➞ L’article de Mohammed Jalal et Naïla Mansour, de Jumhuriya (disponible en arabe uniquement ) explore le vocabulaire de l’intimidation utilisé par le régime syrien, qui comme toute dictature, s’entoure d’une indispensable pompe. L’arabe littéral lui fournit alors quelques expressions solennelles dont il amplifie l’emphase et avive les connotations menaçantes. Lorsqu’un responsable utilise une expression du type «Ahibou bikoum» ( Je vous engage ardemment à…), le sens apparent pourrait laisser entendre qu’il appelle solennellement le peuple à entreprendre une action, qu’il l’exhorte à l’accomplir, mais le sous-entendu est davantage celui d’un ordre. La racine du verbe hâba , dont le sens est celui de «redouter, craindre», donne un autre terme dérivé, haïba qui dans certains contextes pourrait être traduit par «charme impressionnant», «prestige imposant», «redoutable ascendant», mais acquiert dans le contexte d’un pouvoir despotique le sens d’une envahissante «emprise», d’une oppressante «autorité» surtout dans une phrase comme celle de «l’atteinte à l’autorité de l’État». Rejetant l’ambiguïté développée par ces termes ou par des expressions perverses comme celles de «l’amour» pour le «Père-leader», le soulèvement de 2011 a porté l’étendard d’un nouveau vocabulaire, avec des slogans comme «karama», «dignité», expression du peuple souverain.
➞ Cette idée selon laquelle les mots n’enferment pas un seul sens figé, imposé par une seule interprétation possible, est reprise avec originalité par Mona Allam d’Assafir Arabi dans «Ces lectures féministes du Coran», qui remet en question un autre pouvoir, celui des religieux traditionnels. Certains termes de la sourate «Les femmes» peuvent ainsi paraître problématiques s’ils sont lus au premier degré. Mais ils sont réinterrogés par des intellectuelles féministes, qu’elles soient musulmanes occidentales ou intellectuelles arabes.
Interprétations parfois divergentes ayant le mérite d’apporter un souffle nouveau, différent du «parti pris des exégèses traditionnalistes» qui reflètent le pouvoir de «forces tribales et claniques, d’institutions religieuses fondées sur la conservation de la tradition, sans renouvellement». Non seulement le contexte historique est important, mais celui du corpus coranique lui-même. Dans cette vision, le sens des mots ne dépend pas uniquement des règles proprement linguistiques de grammaire et de déduction, mais de l’image générale des femmes, telle qu’elle est véhiculée par l’ensemble des textes sacrés, c’est-à-dire celle d’une égale dignité avec les hommes.
➞ Avec «L’Académie égyptienne au défi des mots» d’Ahmed Waël (Mada Masr), nous passons de la langue du Coran, marquée par l’époque des débuts de l’islam, à «l’arabe moderne standard», langue de notre époque. Si elle a été largement modernisée au début de la Nahda, elle demeure confrontée à la nécessité d’une évolution de plus en plus rapide, en termes de néologismes, pour répondre aux besoins d’une époque dominée par les sciences de l’information. Du pouvoir politique, religieux, examinés plus haut, nous passons ici au pouvoir académique. L’auteur a sollicité l’Académie du Caire, l’une des plus prestigieuses et plus reconnues des diverses académies qui existent dans le monde arabe, mais dont le travail est marqué par des lourdeurs administratives, sur la traduction de termes anglais tels qu’empathy (empathie), overwhelm (submerger), mentor, GIF (Format d’image numérique multimédia, comprenant une image animée, plus court qu’une vidéo et plus riche qu’une photo), abuse (abus), ainsi que de termes relatifs au genre et aux identités sexuelles. L’auteur n’a eu qu’une réponse d’attente de ses interlocuteurs.
➞ La langue arabe sur Internet est également l’un des volets de l’article d’Orient XXI, par Nada Yafi, qui aborde la langue arabe «hors de ses terres» d’origine. Sa présence massive sur la toile où elle occupe depuis quelques années le quatrième rang lui pose des défis en termes de correction linguistique et de «désordre terminologique». Celui-ci est dû à une trop rapide expansion de la langue sur les supports numériques, avec une multiplicité de traductions diverses pour un même terme étranger. La présence dans le paysage audiovisuel de la fousha, langue en principe écrite, marque une renaissance à l’oral et lui offre l’occasion d’un voisinage avec les différents dialectes arabes, voire une interaction avec eux.
La langue arabe hors de son territoire, c’est aussi «la langue de l’Autre» en France. La vision qu’essaie d’en donner la droite est réductrice puisqu’elle la présente comme une langue «communautaire», non comme l’une des grandes langues vivantes du monde. S’il convient de défendre l’enseignement de l’arabe en France, c’est dans un esprit d’ouverture à la diversité culturelle, et non, bien évidemment, dans l’optique absurde d’un «grand remplacement».
Dans tous les cas, les oppositions binaires sont artificielles, qu’il s’agisse d’opposer l’arabe littéral à l’arabe parlé, ou la langue arabe au français. Les combats identitaires sont toujours meurtriers. Dans le monde multilingue dans lequel nous vivons, il ne s’agit pas de faire prévaloir une langue par rapport à une autre, ni de céder à un populisme linguistique quelque peu paternaliste, et encore moins à l’isolationnisme d’un «monolinguisme» impensable de nos jours. L’un des heureux effets de la mondialisation est l’extrême vitalité renouvelée de la langue arabe, dans tous ses états.










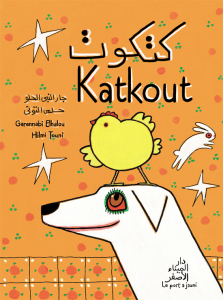 En français, quelques-uns de ces illustrateurs sont disponibles grâce au travail d’éditeurs aussi curieux que courageux.
En français, quelques-uns de ces illustrateurs sont disponibles grâce au travail d’éditeurs aussi curieux que courageux. 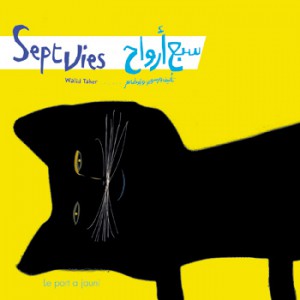 Outre la traduction d’un album de Mohieddine Ellabad signalé naguère, il faut absolument découvrir, si vous ne les connaissez déjà, les éditions du Port a jauni, qui ont publié aussi bien Hilmi Touni que Walid Taher.
Outre la traduction d’un album de Mohieddine Ellabad signalé naguère, il faut absolument découvrir, si vous ne les connaissez déjà, les éditions du Port a jauni, qui ont publié aussi bien Hilmi Touni que Walid Taher.
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.