Ces créateurs ont réalisé des œuvres d’art. Ils ont néanmoins été critiqués pour avoir récupéré des débris de la double explosion du port de Beyrouth. Mais qui peut décider de ce qui est moralement acceptable en matière d’expression artistique ?
OLJ / Par Danny MALLAT, le 19 février 2021 à 00h01
« Si la liberté d’expression artistique implique que l’on peut tout écrire, chanter ou dessiner, alors pourquoi ne pas créer aussi, tant que cela ne fait pas de mal à quiconque ? » s’insurgent plusieurs artistes qui ont travaillé avec les débris de la double explosion du port de Beyrouth le 4 août 2020, et se sont vus sous le feu des critiques, sur les réseaux sociaux, pour une démarche jugée « non appropriée ».
Conçu par le label Vanina, qui produit des sacs et des accessoires de mode, « le sac Silo », ainsi qu’il a été nommé, a été fabriqué à la main avec les débris de verre récupérés après la déflagration. Présenté comme un hommage aux silos du port de Beyrouth, il a été lancé dans le cadre d’une collection intitulée « La lumière de Beyrouth ». En dépit du geste caritatif – 25 % des recettes devaient être versées à la Beirut Heritage Initiative – qui accompagnait la vente, le label a été cloué au pilori sur les réseaux sociaux pour « indécence ». Une levée de boucliers qui a poussé les deux créatrices de la marque, Tatiana Fayad et Joanne Hayek, à retirer leur produit de la vente. Contactées par L’Orient-Le Jour, elles ont décliné tout commentaire, préférant s’exprimer par le biais « d’un communiqué officiel publié ultérieurement », ont-elle affirmé.
Dans ce contexte, les interrogations se multiplient. La création artistique doit-elle se conformer à des normes spécifiques de « ce qui peut se dessiner ou se sculpter » ? Et qui les dicte? Dans l’histoire, l’art sous toutes ses formes a souvent été confronté à ces questions. Comme, par exemple, toutes proportions gardées bien entendu, lors de la parution de La Case de l’oncle Tom, roman publié en 1852, qui dénonçait l’esclavage aux États-Unis, qui fut boycotté et dont l’auteure, Harriet Beecher Stowe, fut menacée de mort. Autre exemple, en 1913, la première représentation du ballet composé par Igor Stravinsky, Le Sacre du Printemps, avait provoqué des émeutes.
Si l’œuvre artistique n’est pas « assimilée » par tous, peut-elle néanmoins être soumise à la censure ? L’artiste peut-il être muselé ? Il faut certes compter avec le passage du temps pour une plus grande acceptation de l’œuvre controversée en son temps, comme celle du sac Silo. Même si l’intention première des deux créatrices n’était à l’évidence pas de blesser ou de heurter les sensibilités, mais de faire ce qu’elles ont toujours fait, créer en étant inspirées par leur ville.

Yara Chaker et Cynthia el-Frenn, « 0408 ».
200 Grs. d’art constructif
Pour Rana Haddad et Pascal Hachem, le duo créatif derrière 200 Grs., utiliser l’art comme outil, comme arme constructive, a toujours fait partie de leur ADN. « L’art peut changer la vision du monde, aider à mieux se comprendre et à comprendre les autres », affirment-ils en ajoutant que toutes leurs œuvres s’inscrivent, depuis toujours, dans une démarche sociopolitique.
Hayat Nazer a quant à elle toujours sublimé sa douleur et celle du peuple libanais dans l’art. À la violence, elle répond par l’amour, et au démembrement, par le désir d’aller vers l’autre. Ses œuvres (Le Phénix, place des Martyrs, La Statue, face au port) tirent leur essence de la souffrance, la sienne et celle de chaque Libanais. Elles sont sa façon à elle de cicatriser les plaies, dans une pulsion de vie pour de ne jamais désespérer.
Cynthia el-Frenn et Yara Chaker, deux jeunes architectes et designers libanais, se sont réunies pour explorer comment le spectateur aborde un espace/objet, l’invitant non pas à regarder, mais à voir. Pour elles, le geste d’un designer se doit d’être intuitif, avec un penchant pour servir l’utilisateur et une idée bien pensée et percutante. Il consiste à servir le créateur en servant l’utilisateur.
5 minutes d’enfer et 3 œuvres pour ne pas oublier
Initié par House of Today (plateforme mise à la portée des designers libanais), un projet de revisiter une matière (le savon) qui accompagne la planète entière depuis le jour 1 de la pandémie fut interrompu. Après la catastrophe du 4 août, le binôme créatif de 200 Grs. va reprendre le concept et le décliner à sa façon (voir notre édition du 21 janvier). Beyrouth est soufflée et l’atelier de Rana Haddad et Pascal Hachem n’est pas épargné. « Nous n’avons pas été ramasser les débris de souffrance dans la rue, nous avons simplement récupéré la nôtre sur place, dans notre atelier, et tout est parti de là. Des heures de travail à insérer les morceaux de verre dans chaque savon, dans une dynamique chirurgicale et thérapeutique », confie le duo. Quand Beyrouth est soufflée, Hayat Nazer se porte volontaire pour aider à nettoyer les maisons et les rues de la ville. Elle nettoyait la journée, ramenait les débris de verre et de métal chez elle, plutôt que de les entasser dans un coin de rue. « La sculpture avait été entamée avant la double explosion, dans un besoin d’attester de l’âme meurtrie (de Beyrouth), mon corps était cassé, dit-elle, et mon œuvre allait s’inscrire dans cette dynamique. » Son œuvre, une femme de verre et d’acier, va reprendre vie pour cimenter un désir de (sur)vie. Il lui a fallu environ deux mois pour la terminer. Hayat Nazer décide de ne pas la nommer. C’était au peuple libanais de le faire.
Après la déflagration, Cynthia el-Frenn et Yara Chaker parcourent Beyrouth, ou ce qu’il en reste. « Tout ce que nous pouvions entendre était le bruit du verre crépitant sous nos pieds et tout ce que nous voyions était de la poussière et de la pierre laissées par les bâtiments effondrés. Voilà comment est né notre objet 0408 », confie Yara Chaker. « Il était extrêmement important pour nous de conserver “l’intégrité” des matériaux avec une intervention minimale, car il ne s’agissait pas de créer un objet parfaitement conçu, mais plutôt d’embrasser l’imperfection, car nous sommes tous imparfaits. Nous avons voulu explorer l’idée d’un objet mémoire, comme une urne, qui, par sa forme, sa couleur et sa matière, reflète l’idée moderne d’une commémoration personnelle mais aussi d’espoir », explique-t-elle.
L’art est-il important pour combattre un trauma ?
« C’était le geste en soi qui nous importait, précise Rana Haddad, notre initiative n’avait aucune symbolique. D’aucuns ont voulu y voir un cercueil, ou ce matériau qui sert aux politiciens à la manière de Ponce Pilate de se laver les mains. Pour nous, il est simplement une cicatrice, une plaie qui ne va jamais se refermer. » « Notre art, ajoute Pascal Hachem, est du slow art, ce n’est pas l’aspect ni le résultat, mais la démarche et la procédure qui comptent, comme si on voulait se donner le temps d’assimiler. On fait appel à l’intensité du quotidien, voilà notre façon de faire, et de conclure, il est sain et essentiel de marquer cet instant. Après 15 ans de guerre, le Libanais n’a jamais eu le temps. Le temps de compter ses morts, de faire son deuil, ni même d’assimiler. À aucun moment, notre travail n’a été une violation de ce temps de deuil. Notre travail est un mantra. La répétition nous aide à comprendre et à expulser notre colère. Nous ne voulons plus être résilient. »
Hayat Nazer a toujours sublimé sa douleur dans l’art. « Il est, dit-elle, un message de moi à moi-même. Après le 4 août, nous partagions tous la même douleur, et cette statue a été un moyen de communication pour canaliser notre désarroi, nous unir et partager, afin de ne pas se sentir seuls. Pendant le montage, j’étais épuisée mentalement et physiquement, j’ai failli abandonner. Comme une branche qui tenait encore après le 4 août et qui s’était brisée. J’ai porté ma douleur et celle des autres et au final la sculpture été mon pharmakon (en grec, le pharmakon désigne à la fois le remède et le poison, NDLR). Je l’ai voulu remède pour les autres. La moitié de la statue est en résignation comme la moitié de chacun de nous, la jambe immobile, la main qui tombe, la balafre sur le visage, les cheveux qui volent à cause du souffle, nous sommes encore à 18h08 le 4 août, alors que dans la deuxième moitié de la statue, la main est levée, elle tient un flambeau et un drapeau, sa jambe est en mouvement. Cette moitié, c’est notre volonté de continuer. Elle représente le peuple libanais. Elle n’est pas une statue de martyr, elle est la statue de notre vérité. Elle est une femme, celle qui donne la vie, celle qui symbolise la (re) naissance », explicite l’artiste.
Pour les jeunes architectes designers Yara Chaker et Cynthia el-Frenn, leur œuvre représente l’espoir, « comme un phénix renaissant de ses cendres ». « Le verre sphérique est utilisé pour suggérer la clarté. Il a été créé en utilisant le verre brisé de l’explosion. Il contient les cendres de la ville. Nous l’avons fait vivre par la technique du soufflage du verre dans une fonderie située à Sarafand. Une sphère imparfaite pour montrer la force et la résilience. Le verre indique le lien entre la vie et la mort, le présent et le futur, le désespoir et l’espoir – un reflet de chacun de nous », soulignent Yara Chaker et Cynthia el-Frenn.
Quid de ceux qui auraient utilisé la tragédie du 4 août pour « commercialiser » leur art ?
« C’est très cliché, répond Pascal et cela ne nous concerne pas. Nous sommes des artistes avant tout, notre travail n’est pas esthétisé. Nous utilisons l’art pour véhiculer un message, c’est le geste qui compte et non l’objet qui en lui-même n’a aucune valeur. Notre travail est simplement notre façon de réagir sur le moment. »
De son côté, Hayat Nazer a été très sollicitée pour vendre sa statue même déclinée en plus petit. « Ce n’était pas le but, dit-elle, je ne pourrais pas l’imaginer ailleurs. Mais si un jour je suis contrainte à vendre mon art afin de pouvoir survivre en tant qu’artiste, je n’hésiterais pas. Mais ce sera ma propre douleur dont il sera question et pas celle de tout un peuple. »
Et lorsque la question est posée à Yara Chaker, elle répond tout simplement : « L’objet se trouve chez moi, il n’a pas lieu d’être ailleurs. Nous sommes des créateurs, pas des commerçants. »
Retrouver l’article original sur



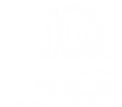









Vous devez être connecté pour poster un commentaire.