« Tous des oiseaux », une pièce autour de l’identité et du conflit israélo-palestinien du metteur en scène d’origine libanaise Wajdi Mouawad a remporté le prestigieux Grand Prix de la critique remis lundi à Paris.
Cette pièce de près de 4 heures en arabe, hébreu, anglais et allemand, est à la fois une fresque historique et l’histoire intime d’une famille juive et prend à bras le corps les déchirures d’aujourd’hui. Présentée au théâtre parisien de la Colline que dirige Wajdi Mouawad, elle a reçu également le prix de la meilleure création d’éléments scéniques.
« Tous des oiseaux » est une prouesse linguistique ; Wajdi Mouawad a entièrement rédigé son texte en français, avant de le traduire en quatre langues qui s’enchevêtrent au fil de la représentation : de l’anglais à l’allemand, en passant par l’arabe et l’hébreu. La langue est en soi un sujet de tension : c’est dans la langue que les personnages se cherchent et qu’ils tentent de se définir, même s’ils sont voués à l’échec. Le texte fondateur est donc à lire dans les sous-titres, qui ont une fonction inversée par rapport à d’habitude. Les mots de la scène ont une existence sonore, presque entièrement sensorielle ; par la fluidité des passages d’une langue à l’autre, on revient à une parole brute, performative et poétique. Les comédiens ont une présence immédiate et habitent leur langue naturellement, de manière saisissante.
Une fois de plus, Wajdi Mouawad explore les brûlures de l’histoire, notamment le conflit israélo-palestinien. Sous nos yeux : une rencontre meurtrière de l’histoire avec l’histoire. Dans Tous des oiseaux, la guerre s’entend : des bombardements assourdissants, des sirènes stridentes d’ambulances, des génériques d’informations, des cris d’enfants qui cherchent leurs parents en arabe et en hébreu, les voix placides des journalistes…
Sur scène, l’ambiguïté des situations de guerre est montrée. Lors d’une fouille de Wahida par une soldate israélienne, on bascule dans l’érotisme, avant que retentisse la détonation d’une explosion. La soldate, de moins en moins crédible, conclut : »Il faut crever l’abcès de l’histoire », mélange des genres décapant entre tragique et comique.
« Quel est l’événement fondateur de Tous des oiseaux ? » avait demandé L’Orient-Le Jour à l’artiste en décembre 2017. « Il y a quinze ans, je me suis posé une question qui peut paraître saugrenue : comment se passe la question du don d’organe en Israël ? Quand un organe vient de quelqu’un qui n’est pas de notre communauté et qu’on est juif orthodoxe, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce que l’organe est accepté ? Le don d’organe est intéressant, car par principe, on ne sait pas d’où il provient. Et si c’est le cœur de son ennemi ? Et si c’est un hutu à qui on greffe un cœur tutsi ? Puis j’ai rencontré Nathalie Zamon Davis, qui a rédigé un livre sur Hassan al-Wazzan, dit Léon l’Africain. Une collision s’est opérée entre le personnage d’al-Wazzan, Nathalie, le thème des dons d’organe, la question de l’ennemi qui vous sauve la vie… », avait-il alors répondu.
Le prix du meilleur spectacle créé en province revient à « Saïgon » de Caroline Guiela Nguyen, pièce événement du estival d’Avignon 2017, sur des récits d’exilés vietnamiens de la première et deuxième génération. « Tristesses », où la metteure en scène belge Anne-Cécile Vandalem raconte à la manière d’un polar scandinave la prise de pouvoir cynique d’une dirigeante d’extrême droite au Danemark, remporte le prix du meilleur spectacle étranger.
Le comédien Benjamin Lavernhe, dont la prestation a été qualifié d' »époustouflante » par la presse, reçoit le prix du meilleur comédien pour « Les Fourberies de Scapin », mise en scène par Denis Podalydès (Comédie-Française). Révélé sur grand écran dans « Le sens de la fête », il était en lice cette année pour le César du meilleur espoir masculin et pour le Molière du meilleur acteur dans le théâtre public.
Côté actrice, Anouk Grinberg a été récompensée pour son interprétation dans « Un mois à la campagne » d’Ivan Tourgueniev, mis en scène par Alain Françon. La presse avait salué son incarnation « subtile » du personnage de Natalia Petrovna, épouse frustrée. « Les ondes magnétiques », une comédie signée David Lescot sur les radios libres dans la France des années 80, reçoit le prix de la meilleure création d’une pièce en langue française.
Quant au prix du meilleur spectacle privé, il couronne « Seasonal Affective Disorder », une histoire d’amour transgressive signée Lola Molina. En musique, le Grand Prix va à l’opéra comique de Daniel-François Esprit Auber, « Le Domino Noir » (direction musicale, Patrick Davin). Et en danse, « Finding now » d’Andrew Skeels et « Crowd » de Gisèle Vienne se partagent le grand prix, tandis que les danseurs de la « Shechter II », compagnie junior du chorégraphe Hofesh Shechter ont été sacré meilleurs interprètes.
Les prix sont décernés par l’association professionnelle de la critique de théâtre, de musique et de danse qui regroupe 140 journalistes de la presse écrite et audiovisuelle, française et étrangère.
Comment devient-on artiste ? Vous avez dit qu’on se forme par « sédimentation »…
Pour Novalis, « toutes les vicissitudes de la vie sont des matériaux dont nous pouvons faire ce que nous voulons ». Le mot le plus important ici est « toutes »; il y a des tempéraments chez qui les perceptions de ce qui arrive s’impriment de manière photographique, et elles restent comme un souvenir. Ensuite, il y en a d’autres par-dessus, elles s’impriment sur cette même surface que sont l’esprit et la sensibilité, et on ne change pas de papier.
Quelques éléments de mon enfance m’ont marqué, comme les récits de miracles pendant la guerre et « les statues qui bougent », cela m’a fondé et passionné. En France, la découverte de la peinture lors d’une sortie scolaire au musée du Louvre. Jusque-là, je n’avais jamais pensé qu’on pouvait peindre… des pommes ! J’avais déjà vu des tableaux dans des églises où on ne regarde pas le tableau, mais le récit. Au Louvre, j’ai compris l’existence d’un tableau. Au Québec, dans le froid, l’hiver, la solitude, en livrant les journaux (ce que faisaient tous les jeunes de mon âge), j’étais porté par des frustrations, mais aussi par des rêves, des désirs, des envies.
Cette surface qu’est notre sensibilité est travaillée en permanence, mais elle doit trouver son mode d’expression, sinon elle reste une matière brute. La révélation peut se faire lors d’un événement expressif : on joue un texte avec des amis, on va au théâtre et ça donne envie d’en faire, on lit des romans, qui ont été édités, et ça donne envie d’être édité…
Quelque chose apparaît alors entre cette sensibilité additionnée et le filon qui permet l’expressivité. Ce chemin est un parcours.
(Lire aussi : « Tous des oiseaux », dit Wajdi Mouawad, et le spectateur y laisse des plumes)
« Trouve un foulard, achète un cahier, va dans les cafés, fume, écris. Fais semblant. » Tel est le conseil d’un directeur d’école canadien à qui vous exprimez votre volonté d’être écrivain. Y repensez-vous parfois ?
J’y pense tous les jours. Faire semblant… L’idée que je suis écrivain ne me rentre pas dans la tête, pas comme les écrivains que j’aime, Novalis par exemple. Mais je me dis que je peux faire semblant, c’est possible. Plus le déguisement est vrai, plus c’est vrai, et donc plus ce que je fais ressemble à une pièce de théâtre. Ça aura l’air d’une œuvre d’art, mais c’est un faux. Cette distance, c’est ce qui me libère le plus, ça me permet de ne pas arrêter.
Comment rédigez-vous vos pièces ?
Dès que je commence à exprimer l’envie de faire un spectacle, je dois tout raconter, sinon ça ne se fera pas. Il faut parfois sept ou huit ans avant de parler. Ensuite, définir le nombre d’acteurs, les engager et puis raconter. Le texte s’écrit au fur et à mesure des répétitions, après avoir été confronté à l’équipe pour le récit oral – toute l’équipe : des techniciens aux comédiens… Je suis fragmenté par la parole des autres. Cette fragmentation permet plus de compréhension et plus de richesse des mots, et là, les idées viennent. Alors, je note, je décante. Quelque chose se dépose sous forme de structure dramatique, puis c’est un travail de théâtre : on travaille les scènes. En travaillant au plateau, je travaille le texte, je tire des fils. Je crois que ma méthode est assez commune, c’est celle de Sophocle ou de Shakespeare, à l’époque où les auteurs étaient des metteurs en scène. Je ne peux pas écrire puis mettre en scène ; pour moi, c’est à l’envers, et j’écris avec tout. Le plateau devient mot, la chaise déplacée, la présence d’un acteur : ce sont des mots. Tout est mis ensemble pour former un texte. Le spectacle utilise des écritures diverses et tout est écriture : le nom du personnage et sa réplique, une réplique prononcée au bord de la mer, le bruit des vagues… Le choix du corps de l’acteur est écriture : un acteur gros écrit déjà des choses. Le texte est une écriture, mais pas la seule.
(Pour mémoire : David Grossman dans les yeux de Wajdi Mouawad)
Auteur et directeur de théâtre : comment fonctionne l’équation ?
Je n’ai pas un tempérament monastique et être totalement dédié au théâtre, à l’expression, au point de tout sacrifier (famille, vie sociale…) me semble difficile. Le pire, c’est de faire ce qui n’est pas dans son tempérament. Et pour moi, le rapport au monde, au réel, au social, est très important. La création ne supporte aucune intrusion du monde réel. Or, dans les moments de création, rien n’est important, d’où la volonté de franchir le pas suivant et de m’ouvrir au monde : qu’est-ce que je peux faire ? Comment participer ? Diriger un théâtre relève de ces questionnements. Le rapport à la création me déstabilise et j’ai besoin de cette ouverture : m’occuper de l’équipe, de l’écriture des autres, des gens du quartier, du public, des jeunes… Passer de la création à la direction du théâtre de la Colline correspond à mon tempérament.
Vous semblez proche des jeunes et avez à cœur de les impliquer dans l’actualité de la Colline. Est-ce par souci de transmission ?
Je suis attaché à cette période de la vie, lorsqu’on est sorti de l’enfance. Le monde est un horizon immense, on a l’élan de l’enchantement et l’espoir peut se fonder. La jeunesse observe le monde qui l’a éduqué. Forte de son observation, elle veut faire les choses à sa façon, c’est beau, génial et pas mortifère. J’aime d’autant plus ça que je ne m’associe pas à eux. Plus j’avance en âge et plus j’aime ça. Le monde leur appartient, il y a quelque chose de tellement vivant en inventant le langage, ils ont de nouvelles préoccupations, ils sont à un âge où ils ont besoin de parole, de mots, de dialogue… J’ai envie d’être avec eux comme j’aurais aimé qu’on soit avec moi.
Que souhaitez-vous à la jeunesse libanaise ?
Je lui souhaite une manière nouvelle de faire de la politique par le décloisonnement, l’intelligence et la sensibilité. Elle doit se demander comment l’expérience traumatique commune de la guerre pourrait être un espace de reconstruction, une reconstruction non clivée. La jeunesse libanaise doit rejeter les clivages que ses grands-parents ont subis et entretenus.
(Pour mémoire : Un rendez-vous déjanté avec la mort)
Quelle est la place du temps dans votre écriture ?
Pour moi, il y a trois temps : le temps historique, le temps messianique ou religieux (on attend quelque chose) et le temps métaphysique
Dans mes pièces, on trouve une combinaison des trois. L’histoire et la situation historique sont déterminants (les deux guerres mondiales, la guerre du Liban…) : je vois l’histoire comme une goudronneuse dans nos existences. Elle écrase le temps des individus (la guerre civile libanaise a défait de nombreuses familles) et fait apparaître des thèmes adjacents (nostalgie, mélancolie…).
La combinaison de ces trois temporalités crée le temps du théâtre du début à la fin de la pièce. L’enjeu pour l’auteur et le spectateur est le même : comment traverser le temps de la représentation ?
Quel est votre lien avec le public ? S’agit-il d’un rapport de séduction ?
C’est une relation, et la séduction est présente dans les prémices. Il doit y avoir de la séduction dans la manière d’aborder une histoire. Mais très vite, l’histoire d’amour entre l’auteur et le spectacle tourne au vinaigre : la séduction devient une menace, car une guerre s’opère entre l’auteur et son texte. Le danger pour un auteur, c’est d’être trop séduit par son spectacle. Parfois il faut couper, renoncer, avancer avec un couteau pour aiguiser le texte. Quand le public arrive, l’amour et la séduction prennent tout leur sens…
Comment avez-vous vécu votre immense succès depuis Littoral et Incendies ?
Très, très mal. Je ne sais pas comment le gérer. Je ne sais pas ce qu’il signifie, je ne le personnalise pas : j’ai l’impression qu’il s’agit de quelqu’un d’autre. J’essaye de m’abstraire de rapports avec le public, je l’évite, je ne sais pas comment le porter, et je me sens faux quand je le vois.
Travaillez-vous sur un projet de roman ?
Oui, il a encore besoin de quelques années. Je n’ai pas le désir d’avoir une œuvre romanesque très nombreuse. Avec quatre, je serai content.
Mon prochain roman est costaud, le Liban est encore au centre ; en fait, il est au centre de chaque partie de mon œuvre. Pour rédiger un roman, je pars d’un fil. Formellement, c’est très complexe. Cette fois, c’est un événement de mon enfance. Quand la guerre a commencé, mon père nous a fait faire 5 visas : pour l’Égypte, le Royaume-Uni, la France, les États-Unis et l’Italie. Quand il a fallu quitter le Liban très vite, mon père a envoyé mon frère à l’aéroport pour qu’il se renseigne sur le départ le plus rapide vers une de ces destinations. Et ce fut la France. Que serais-je devenu si ça avait été l’Italie ? Je vis avec quatre frères jumeaux à l’intérieur de moi, et mon prochain roman met en scène ces cinq possibilités.
Tous des oiseaux est votre nouveau spectacle, le premier que vous présentez à la Colline. Que veut dire ce titre ?
La pièce s’appelait au départ Le chant de l’oiseau amphibie, mais j’ai trouvé le titre trop réducteur, car ce texte parle de tout le monde. Il renvoie à de l’aérien, du mouvement : l’oiseau ne reste jamais posé très longtemps et ce mouvement nous concerne tous. L’identité fixée n’existe plus, elle devient même étrange.
(Pour mémoire : Wajdi Mouawad là-haut sur la Colline)
Vos textes naissent souvent d’une rencontre. Quel est l’événement fondateur de Tous des oiseaux ?
Il y a quinze ans, je me suis posé une question qui peut paraître saugrenue : comment se passe la question du don d’organe en Israël ? Quand un organe vient de quelqu’un qui n’est pas de notre communauté et qu’on est juif orthodoxe, qu’est-ce qu’on fait ? Est-ce que l’organe est accepté ? Le don d’organe est intéressant, car par principe, on ne sait pas d’où il provient. Et si c’est le cœur de son ennemi ? Et si c’est un hutu à qui on greffe un cœur tutsi ? Puis j’ai rencontré Nathalie Zamon Davis, qui a rédigé un livre sur Hassan al-Wazzan, dit Léon l’Africain. Une collision s’est opérée entre le personnage d’al-Wazzan, Nathalie, le thème des dons d’organe, la question de l’ennemi qui vous sauve la vie…
Dans Tous des oiseaux, vous êtes-vous senti dépossédé de votre langue d’écriture, le français ?
Dans mes textes précédents, je n’ai pas posé la question de la langue. Tous des oiseaux, c’est l’histoire d’une famille juive éclatée sur trois continents, et les différentes langues se sont imposées.
Il était important de respecter les langues originales des personnages. J’ai dû modifier ma méthode et la décaler : j’ai écrit avant de répéter, car il a fallu traduire mon texte en quatre langues, anglais, allemand, arabe et hébreu, avec des surtitres en français. Comme auteur, je me suis retiré : on n’entend pas ma langue d’écriture. Les surtitres ne sont pas le texte complet. Il y a eu la disparition de ma langue, peut-être ai-je voulu revivre la disparition de ma langue maternelle quand j’ai quitté le Liban avec ma famille ? Oui, c’est bien une dépossession, mais maîtrisée.
Poétique et politique se retrouvent-elles sur scène ?
Dans ma dernière pièce, elles se rejoignent très nettement. La situation est d’emblée posée en termes politiques, en mettant en scène trois langues problématiques ensemble : l’arabe, l’allemand et l’hébreu. En cas de litige, on emprunte l’anglais. D’une certaine manière, la situation du Moyen-Orient est liée à la langue allemande. Dans mon spectacle, je les mets ensemble dans un conflit familial. Cela articule une situation intime avec une situation plus globale, et c’est ce qui m’intéresse : comment l’intime est bouleversé par la marche du monde.
La figure de l’ennemi est récurrente dans votre œuvre. Que dire de cette thématique dans le Liban actuel ?
Au Liban, le contexte de guerre est encore très présent, cela vient de la façon dont nous vivons les suites de la guerre. Je remarque que chacun des clans de la mosaïque est incapable de faire un travail sur lui-même, incapable de prendre de la distance par rapport à ses responsables, à ce qu’ils ont fait. Chacun se focalise sur ce qu’il a subi. Tant que personne ne se responsabilise, la réconciliation est impossible. Je ne peux pas faire ce travail pour un autre clan. À partir de là, une question : quelle est la part de responsabilité de mon clan, ce clan auquel je suis attaché et où je me reconnais ? En essayant d’y répondre, j’agis dans un sens qui me semble juste. C’est ce qui arrive dans d’autres communautés : des artistes, des sociologues, des journalistes le font. Mais quelque chose résiste, l’amnésie résiste.
C’est la question de l’engagement de l’artiste qui est en jeu ?
Dans le contexte politique régional, la question de l’engagement se pose à plus forte raison quand on est écrivain : que faire ? Écrire contre ? Écrire pour ? Ne pas écrire ? Écrire pour aller dans le sens des souffrances de mon propre peuple ? Mais mon peuple non plus n’est pas l’innocente victime, comme on a voulu me le faire croire. Quel chemin suivre quand il n’y a pas d’espoir de voir ce conflit s’achever ? Si la réconciliation est très éloignée, la destruction est impensable. Reste alors une situation de pourrissement qui se transmet de génération en génération.
Ma manière d’être consiste à refuser de conforter mon clan, à agacer mon camp, celui des Libanais chrétiens de confession maronite. On m’a appris à détester tous ceux qui n’étaient pas de mon clan. Sans le préméditer, lorsque j’ai commencé à écrire du théâtre, je me suis obstiné à créer des personnages, qui étaient justement ceux que l’on m’avait fait haïr, en leur donnant les plus beaux rôles, en faisant d’eux les vecteurs des plus fortes émotions.
Il en va ainsi des musulmans dans Incendies et d’un Palestinien dans Anima. J’ai envie d’écrire et d’aimer les personnages de Tous des oiseaux ; c’est insignifiant, ça n’apportera pas la paix, mais c’est aussi le rôle du théâtre : aller vers l’ennemi, contre sa propre tribu. Quant à ceux qui, ces derniers temps, ont soulevé la question du soutien de l’ambassade d’Israël à Tous des oiseaux, ils méconnaissent malheureusement la production en spectacle vivant. L’ambassade a payé les billets d’avion des artistes israéliens qui sont sur ce plateau, comme il se fait très régulièrement dans le théâtre. Rien de plus
La question de l’identité semble résolument être au cœur de votre écriture…
Oui – ou plutôt, le danger de la corrélation entre identité et origine. Je dirai toujours que mon origine est libanaise, mais mon identité n’est pas la même aujourd’hui que dans dix ans. L’identité continue à évoluer, elle est devant moi. Elle n’est pas fixée par l’origine, c’est un rêve. C’est une construction active avec les autres, avec soi, elle est en chemin, elle n’est pas la maison. C’est la confusion entre identité et origine qui crée le rejet.
« Maintenant, nous sommes ensemble, ça va mieux. » Cette phrase extraite d’Incendies résume-t-elle votre approche du théâtre ?
Le théâtre, ce sont des vivants ensemble, il n’y a pas de morts. On regarde des gens vivants. Alors que le cinéma est un rapport solitaire (chaque spectateur est seul devant l’écran), au théâtre, le groupe apparaît autour d’une parole. La danse aussi, mais ce n’est pas autour d’une parole. Le théâtre est un rassemblement autour du langage, des mots, de l’écriture, de ce qui nous définit comme humains. On est rassemblés autour de ce qui nous détermine. Au théâtre, on n’essaye pas de convaincre, on se pose des questions : qui sommes-nous ; comment faire face à la vie et à la mort; qu’est-ce que les enfants ; qu’est-ce que le mal ? Quand on se pose ensemble une question profonde, ça va mieux.
Vous rêvez d’un « miracle, d’un spectacle qui bouleverserait tellement les gens qu’en sortant ils seraient transformés »…
Les récits et les émotions sont des vecteurs de transmission et de transformation. Ce n’est pas dogmatique. Ce que je propose s’additionne à d’autres propositions. Attention au danger des émotions qui peuvent manipuler le spectateur. Le défi est de créer de façon que l’émotion jaillisse là où on ne l’a pas calculée. Pour cela, on travaille par ricochet, par aveuglément. On ne travaille pas en ligne directe, sinon on est dans la manipulation. C’est très intuitif, il ne faut pas voir le poisson, mais le deviner, aller vers lui, et avancer comme Orphée.


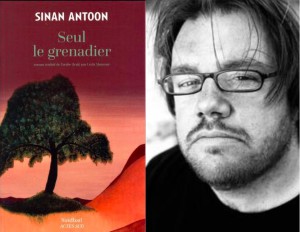


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.