Il ne faut jamais sous-estimer l’ignorance qui irrigue parfois les films et les séries américaines sur le monde arabe et musulman. Dans l’épisode de Homeland sur la Syrie, tourné en Afrique du Sud, les acteurs arabes locaux engagés pour faire les terroristes et sécréter de la haine devaient aussi écrire des graffitis antiaméricains dans le camp de réfugiés. Selon le Guardianbritannique qui rapporte l’histoire, les artistes ont d’abord songé à décliner la proposition, « jusqu’à ce que nous réalisions que nous pouvions faire passer notre désaccord avec la série ». Ainsi, l’héroïne Carrie passe devant des graffitis en arabe qui proclament : « Homeland est raciste », « Homeland n’est pas une série », « Ne faites pas confiance à cette histoire », « Ce programme ne reflète pas la vision des artistes ». Ce fut un immense éclat de rire dans les pays arabes. Personne ne savait lire l’arabe dans l’équipe de tournage !
LE « BAD GUY » ET LA FEMME BLANCHE
Jack Shaheen, de l’université du Sud-Illinois a étudié les « mythes d’Arabland » dans un documentaire et un livre, Reel Bad Arabs : How Hollywood Vilifies a People (Interlink books, 2009) depuis les débuts du cinéma. Selon lui, seuls les Indiens auraient été plus maltraités à l’écran. L’Arabe est devenu un raccourci du bad guy,longtemps après que l’industrie du cinéma a eu accepté de modifier la représentation d’autres groupes minoritaires. Dans les quelque 300 films aux personnages musulmans (Arabes ou Iraniens) étudiés, on retrouve la même proportion de « navets » que pour les westerns, faisant d’eux l’ennemi public n° 1, brutal, refusant la civilisation occidentale qu’il entend détruire par la terreur.
L’Arabe des films historiques vit dans le désert avec son harem et ses femmes qui dansent la danse du ventre en voilages légers. Le chef est ventripotent, le vizir est un traitre parfaitement caricaturé dans Aladdin de Walt Disney. La fille du sultan est toujours jouée par une actrice blanche « orientalisée ». Le stéréotype du « cheik » (personnalisé par Rudolph Valentino en 1921 dans le film éponyme, puis dans Le fils du cheik en 1926) est directement inspiré de l’orientalisme pictural et romanesque européen. Dans le film musical Harum Scarum, (C’est la fête au harem, 1965), Elvis Presley sauve la vie d’un émir qui lui fait cadeau d’un harem. Mais Elvis reste fidèle à sa fiancée au pays.
Les Mille et une nuits ont inspiré au moins une dizaine de films. Dans Aladdin de Disney (1992), le premier couplet de la chanson du film (en anglais) annonce qu’on est dans un pays où « on torture et coupe la main des voleurs ». L’Arabe, bandit de grand chemin, attaque les caravanes comme les Indiens dans les westerns, vit dans une oasis et recherche toujours une femme blanche, comme dans Le Diamant du Nil (1985), ou dans Never say Never again (Jamais plus jamais, 1983) avec la mise aux enchères de Kim Basinger au profit de lubriques Arabes.
La crise de 1973 et la hausse brutale des prix du pétrole traumatisent la société américaine en profondeur. Avec le film Network (Main basse sur la télévision (1976), le personnage (nouveau) de l’émir du Golfe richissime, idiot et cupide achète toute l’Amérique. Dans une des scènes, le présentateur de télévision appelle les Américains à crier leur haine à leurs fenêtres, rappelant les discours hitlériens de dénonciation des juifs lors de la Nuit de cristal1.
LA FIGURE DU TERRORISTE POST 11-SEPTEMBRE
Les attentats du 11 septembre 2001 à New York et Washington constituent un choc analogue à l’attaque de la flotte de guerre américaine par les Japonais à Pearl Harbor le 7 décembre 1941, et le musulman prend largement la tête du classement des méchants. Le créneau, déjà bien fourni avant cette date — avec Under Siege (1986) ; Wanted : dead or alive (1987) ; True Lies(1994) —, trouve un nouveau souffle avec la série Homeland(2011), ou les films World War Z (2013) ; Teenage Mutant Ninja Turtles (2014) et American Sniper (2014). Les feuilletons télévisés Sleeper Cell ou Homeland traitent le cas des cellules islamistes dormantes, alimentant de façon hebdomadaire la peur de l’ennemi caché. Dans la série Generation kill (2008) sur une section de marines en Irak en 2003 (un site lui est consacré), il n’y a aucun héros irakien. Aucun personnage irakien positif non plus dans le film American Sniper, histoire du sniper américain Chris Kyle, alors que sur Internet circulaient les exploits du sniper irakien « Juba », beaucoup moins photogénique.
L’American-Arab Anti-Discrimination Committee jugeant ces présentations insultantes et injurieuses, déclarait : « Chaque fois qu’un Arabe accomplit le rituel de se laver les mains avant la prière, cette image annonce au spectateur qu’il va y avoir de la violence. » Quelquefois, ces protestations aboutissent, mais c’est rare. The sum of all fears (La somme de toutes les peurs, 2002) tiré d’un roman de Tom Clancy imaginait un attentat de terroristes arabo-islamistes durant le Super Bowl2. On est alors dans l’immédiat après 11-Septembre et George W. Bush tient à se démarquer de l’idée d’une guerre religieuse contre l’islam. Devant la protestation du Council on American-Islamic relations, les terroristes arabes sont transformés en néonazis européens.
Mais c’est l’exception. L’Arabo-irano-terroriste sert à mettre du piment dans des scénarios qui s’essoufflent. Dans Back to the Future 1 (Retour vers le futur 1, 1985), un terroriste libyen mitraille le savant sans qu’on sache très bien quel est le rapport avec l’histoire. Dans Prison Break, saison 2, 15e épisode, l’agent Kim exige d’étouffer une affaire : « Allumez un feu de forêt en Floride ou n’importe quoi (…) ou trouvez un entrepôt plein d’Arabes »3.
TOUS LES MÉCHANTS UNIS DANS LEUR HAINE DES ÉTATS-UNIS
Le terroriste est un maniaque au regard fou, mais un peu idiot : dans Retour vers le futur 1, sa mitraillette s’enraye et sa camionnette refuse de démarrer ; dans True lies il se fait subtiliser par une jeune fille la clé du détonateur nucléaire. Mais caché dans les étages d’un gratte-ciel, il ne peut rien contre le calme froid d’Arnold Schwarzenegger aux commandes de son avion à décollage vertical (probablement stationné au pied de l’immeuble). Le sommet du délire est atteint dans Rules of engagement (L’enfer du devoir, 2000). Le colonel Terry Childers est appelé pour évacuer l’ambassade américaine au Yémen face à une foule armée et incontrôlable. Il ordonne d’ouvrir le feu et tue une petite fille unijambiste. Devant un tribunal militaire, abandonné de tous, il est défendu par le colonel Hodges qui va démontrer qu’il y avait légitime défense : même la petite fille unijambiste de 10 ans tirait au pistolet sur les GI.
Dès lors le Proche-Orient devient un melting-pot dans lequel tous les méchants collaborent. Homeland montre un camp du Hezbollah chiite, plein de réfugiés syriens venus de la région sunnite de Rakka. Un Syrien sunnite fuyant les bombes du régime de Bachar Al-Assad se réfugie dans une zone contrôlée par le Hezbollah chiite dirigé par un cheikh sunnite ! La série américaine Army Wives (2007) imagine une petite orpheline irakienne accueillie dans une famille, qui reconnait « que les Américains ne veulent pas de mal au peuple irakien »,contrairement à ce que racontent des gens dans son pays, et elle apprend à faire la cuisine (américaine).
En revanche, pas un mot ni un film contre l’Arabie saoudite, excepté The Kingdom (Le Royaume, 2007) évoquant l’attaque terroriste sur le compound (camp) d’Al-Khobar en 1996. Le film suit l’enquête d’un membre du FBI sur l’attentat qui tua 19 soldats américains. Il a été censuré par le Koweït et Bahreïn, mais pas par Riyad car le collaborateur saoudien n’a pas le mauvais rôle. Le scénario sous-entend la responsabilité du Hezbollah chiite pour ne pas accuser Al-Qaida. William Perry, secrétaire américain à la défense, avoua pourtant dans une entrevue accordée en 2007 : « Je pense désormais Al-Qaida plutôt que l’Iran responsable de l’attentat de 1996 visant la base américaine. » Le ministre de l’intérieur saoudien de l’époque confirmera ses dires, mais cela ne convenait pas aux scénaristes d’Hollywood.
DES FILMS INTERDITS OU CENSURÉS
Cette obsession hollywoodienne génère des effets en retour. Pour la population arabe, tout film critiquant le monde arabe est hollywoodien, comme le très mauvais film d’amateur Innocence of Muslims (L’innocence des musulmans, 2012), diffusé sur YouTube, qui présente les musulmans et le Prophète comme immoraux et brutaux. Les manifestations antiaméricaines ont fait quatre morts en Tunisie, quatre en Libye, deux au Soudan et un au Liban. Des dignitaires religieux eux-mêmes en rajoutent. Khaled Al-Maghrabi, de la mosquée Al-Aqsa du Caire — emprisonné dans le passé pour ses discours racistes — affirme dans un sermon de 2017 que la série Les Simpsons, « création des adeptes du Diable qui complote depuis 17 ans » avait annoncé l’arrivée au pouvoir de Donald Trump, et les attentats du 11-Septembre.
La liste des films hollywoodiens interdits dans certains pays musulmans est sans surprise : Not Without My Daughter(Jamais sans ma fille) en Iran ; The Matrix Reloaded, interdit en Egypte parce qu’il remet en question le dogme de la création divine de l’univers ; Alexander (2004), interdit en Iran à cause de la relation homosexuelle du héros avec Hephaistion, le président Mahmoud Ahmadinejad ayant affirmé que de telles déviations sexuelles n’existaient pas dans son pays. Dans 300 (2007) et sa suite 300 2 (La naissance d’un empire, 2014) sur les batailles de Marathon et de Salamine, Darius — toujours en maillot de bain — ressemble à un punk américain drogué couvert de tatouages et de piercings. Les Perses sont des barbares incultes et agressifs. Thémistocle, le super héros qui doit rester au centre de l’écran ne peut pas être mélangé avec la formation serrée et disciplinée d’hoplites qui seule permit la victoire, (mise en scène oblige). En somme le film décrit les Perses comme Ahmadinejad décrit les juifs et les Américains aujourd’hui. Body of Lies (Mensonges d’État, 2008) reprend la thèse de la complicité de l’Iran avec les leaders d’Al-Qaida, mais aussi avec le trafic de drogue.
Au bout du centième épisode de la septième saison de Homeland(une huitième est en préparation), nous aurons fait le tour complet du Proche-Orient : l’Irak et l’Afghanistan, puis le Liban et la bande de Gaza, le Yémen, l’Iran et enfin la Syrie, sans oublier une pincée de Venezuela et, pour la septième saison, la Russie (toujours rien sur l’Arabie saoudite). Les organisations terroristes collaborent entre elles, quelles que soient leurs divergences : Al-Qaida, Hezbollah libanais, talibans, services pakistanais et organisation de l’État islamique (OEI) s’entendent très bien à Beyrouth, ville de miliciens et de femmes voilées. Pour mémoire, Homeland est l’adaptation de la série israélienne Hatufim qui raconte la même histoire. Une version russe est en cours qui sera certainement considérée comme de la propagande par les pays occidentaux4.
Enfin, les Palestiniens peuvent cacher des zombies. Dans World War Z (2013), le héros à la recherche de l’endroit sûr pour éviter les morts-vivants se réfugie à Jérusalem sur le conseil des militaires. Le territoire a été préservé de l’invasion par le mur de séparation de 6 mètres de haut et 700 kilomètres de long, érigé par les Israéliens contre les Palestiniens. C’est ce qu’on appelle un mur à double usage : contre les Palestiniens et les zombies. Dans Delta Force (1986), l’organisation mondiale New revolutionaries se réclamant de l’ayatollah Khomeini détourne un avion finalement libéré par le commando, non sans que Chuck Norris n’ait affronté le chef du commando en combat singulier. À bord, les commandos trinquent avec les otages libérés dans une étonnante interprétation de l’hymne America The Beautifulvantant le multiculturalisme et le patriotisme. On n’a pas souvenir d’un détournement d’avion commis par des militants khomeinistes, mais est-ce si grave ?
Dans Zero Dark Thirty (2012) qui raconte la traque d’Oussama Ben Laden, le film s’attarde longuement sur des séances de torture conduites par la CIA. Est-ce que celles-ci ont aidé la CIA à trouver la cachette de Ben Laden au Pakistan ? Le film n’est pas explicite à ce sujet.. Le président George W. Bush a validé juridiquement la torture en demandant à d’éminents juristes trois memorandum exploitant les limites des Conventions de Genève afin de priver « légalement » les prisonniers de la protection du droit international. Lors de la Journée internationale de soutien aux victimes de la torture en juin 2003, Bush n’en affirme pas moins que les États-Unis « se consacrent à l’élimination mondiale de la torture et qu’[ils] sont à la tête de ce combat en montrant l’exemple ».
LE POIDS DE LA GUERRE D’IRAK
Mais les choses changent là où on ne les attend pas, obligeant Hollywood à commencer à réfléchir. Les soldats sont devenus des cinéastes et ils ont vécu les horreurs de la prison d’Abou Ghraib, le massacre de Mahmoudiya en 2006, les vidéos de cadavres brûlés… « Pour le Vietnam, il a fallu attendre plus de dix ans entre le climax 1965-1968 et Apocalypse now (1979) ou Voyage au bout de l’enfer (1978) ; « aujourd’hui l’information s’accélère, il faut réagir plus vite », explique le réalisateur Paul Greengrass. Maintenant les films sortent alors que la guerre se poursuit.
Face à la difficulté de critiquer la politique officielle, les scénaristes privilégient toujours le thème fréquent du cinéma de guerre post-Vietnam, à savoir le traumatisme du combattant ou l’impossible retour au pays, mais restent muets sur le vécu des Irakiens ou des Afghans. Le film The Hurt Locker (Démineurs,2008) raconte le quotidien d’une équipe de déminage, avec sa dose d’adrénaline, mais le film évite le questionnement sur le bien-fondé du conflit et ses conséquences sur la population locale. L’invisibilité de l’ennemi sert à la fois à le rendre plus dangereux et à lui retirer son droit à la parole, voire à le déshumaniser. In the Valley of Elah (Dans la vallée d’Elah, 2007), le sujet reste les graves troubles psychologiques dont est victime le héros déserteur qui avait renversé un enfant avec un véhicule militaire.
Dans Redacted (2007), Brian de Palma choisit le mode documentaire pour évoquer des événements réels de la guerre en Irak, comme le viol d’une fillette de 14 ans par les marinesaméricains ou les attentats-suicides aux points de contrôle, s’inspirant des vidéos postées sur Internet par les soldats. Mais le film n’est sorti que dans 15 salles et il lui a été reproché de faire de la propagande antiaméricaine. Battle for Haditha (2007) est inspiré d’un attentat contre un convoi de marines en Irak qui causera en représailles la mort de 24 innocents en novembre 2005. Good Kill (2014) traite de la guerre moderne, celle qui se joue à coup de bombes lâchées par des drones pilotés par des soldats qui ne quittent pas le sol américain à travers un militaire antihéros dépressif. Il accuse les États-Unis d’attiser la haine et de fabriquer des terroristes.
Les films de pure propagande deviennent plus rares, mais le panel arabo-musulman reste suffisamment large et fourni pour que les scénaristes conçoivent encore quelques dizaines de films, de séries télévisées pendant une petite décennie avant que le filon ne s’épuise. Du moins l’espère-t-on.

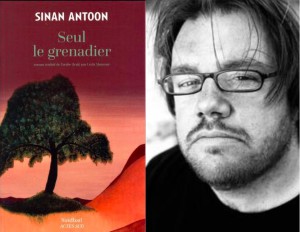

Vous devez être connecté pour poster un commentaire.