Afin de comprendre le Liban d’aujourd’hui, je dois un peu remonter dans l’histoire du pays. Et, afin de ne pas me tromper dans les dates, ou dans la logique, j’ai préféré écrire un texte et vous le lire, réduisant ainsi les possibilités d’erreur (et de bêtises) et laissant la libre-pensée à la discussion ultérieure.
Le Liban actuel est un petit pays composé de 4 régions parallèles. Une zone côtière, 2 chaînes de montagne parallèles (dites du Liban ou Mont-Liban et celle de l’Anti-Liban, séparant le Liban de la Syrie), et un plateau entre ces deux chaînes de montagne (la plaine de la Bekaa).
La construction politique libanaise est le résultat d’une alliance entre ces 4 zones géographiques ou plutôt 3 zones aux caractéristiques sociales distinctes : les habitants de la mer, les habitants de la montagne et ceux de la plaine.
Cette alliance n’est pas née du jour au lendemain et ne s’est pas construite sans heurts ou conflits, souvent sanglants.
Elle a commencé en 1516, avec la victoire partielle des Ottomans sur les Mamelouks, et avec l’accession au pouvoir de la famille des Maan qui formèrent en 1544 l’Emirat de la montagne, la première structure juridico-politique, certes féodale, mais différente (avec une presque autonomie) de celle de l’Empire Ottoman, résultat d’une forme de rébellion et d’indépendance. La capitale devint Deir El Qamar dans la montagne libanaise.
Cette première alliance fut conclue entre 3 communautés de la montagne, les druzes, les maronites et les chiites (minoritaires dans ces régions) par crainte que leur ressentiment d’« exclus ou de minoritaires » à l’époque des mamelouks, sunnites, ne se reproduise dans l’empire ottoman, également majoritairement – mais pas exclusivement – sunnite. Cette crainte les unifia et les rassembla.
Ce fut donc une alliance de populations opposées à l’« occupation », quelle qu’elle soit. Premier contrat signé entre des indépendantistes contre des occupants, au-delà des différences confessionnelles. La notion d’indépendance et de rébellion domina cette première entente.
Ainsi naquit l’embryon de l’état libanais dans la montagne, imbu de la mentalité de celle-ci, soit de ne compter que sur soi-même (assurance de soi), de la grande solidarité (avec les autres montagnards) contre les attaques extérieures, et d’un solide attachement à une terre et un sol.
L’autonomie de cette petite région de la montagne (dénommée le Mont-Liban) se développa et traversa plusieurs époques, souvent agitées.
Durant cette même période, les Puissances Occidentales avaient déjà signé (depuis le 16ème siècle) avec l’Empire Ottoman les Capitulations, qui permettaient à ces Puissances de protéger les ressortissants respectifs de leurs pays, résidents au sein de l’empire, y compris de les juger selon les règles en vigueur dans leur propre pays et non pas selon les lois de l’Empire.
C’est ainsi que ces Puissances préparant – déjà – l’après-Empire, utilisèrent les communautés locales pour s’insurger contre la Sublime Porte.
Mais, ces mêmes Puissances Occidentales, qui se battaient aussi entre elles, exploitèrent les divergences locales, claniques, familiales et confessionnelles, en opposant leurs protégés locaux les uns aux autres afin de se garantir une base locale importante pour leur expansion future.
Ils provoquèrent ainsi plusieurs conflits principalement confessionnels.
Ce fut à cette époque que les Maronites, soutenus par les Français, prirent de plus en plus d’importance, et « conquirent » ou « convertirent » les chiites de la montagne (du Kesrouan).
Il ne restait donc plus que deux grandes communautés importantes dans la montagne libanaise, les druzes (soutenus par les Anglais) et les maronites. Les conflits entre ces deux communautés (en fait entre les Français et les Anglais) s’exacerbèrent jusqu’à en devenir intenables. Les Puissances étrangères tentèrent alors d’imposer (en 1842) un système confessionnel, le double Caïmacat – soit la séparation entre les régions maronites du Nord du Mont-Liban et les régions druzes du Sud du Mont-Liban. Celui-ci ne survécut pas aux massacres horribles qui eurent lieu en 1860.
Trop c’est trop, un nouveau système de gestion politique autonome est mis en 1861 en place, la Moutasarrifyyah. Un système, qui réunifia les zones que les Puissances Etrangères ont voulu diviser et qui perdurera jusqu’à la chute de l’Empire Ottoman en 1918.
Le Moutasarrif était un citoyen ottoman de confession chrétienne – choisi par la Sublime Porte – mais obligatoirement avalisé par les Puissances Occidentales (la France, la Grande-Bretagne, l’Autriche-Hongrie, la Russie et la Prusse). (Il y en eut 8 jusqu’en 1918). La nouvelle capitale devint Baabda, plus proche de la côte et les premières institutions se mettent en place, dont un Conseil Consultatif central, sorte de Gouvernement.
Le système féodal mis en place dès le 16ème siècle et dirigé par la famille Maan (1516 à 1697) puis par les Chéhab (1697 – 1840) laissa place à un système de plus en plus autonome avec des institutions de plus en plus sophistiquées et indépendantes.
Ce système renforça l’alliance des gens de la montagne et prouva finalement que les séparer sur une base confessionnelle n’est pas viable. La solidarité de la montagne l’a emporté.
Cette fois-ci l’esprit d’indépendance se renforça et la notion d’autogestion commença à s’implanter dans l’esprit des habitants de la montagne, tout en préservant la diversité des opinions, des religions.
A la chute de l’empire ottoman en 1918, à la fin de la 1ère Guerre Mondiale, le dépouillement par les Vainqueurs de cet empire aboutit à une nouvelle formule inventée (le 28 juin 1919) par la nouvellement créée SDN (Société des Nations) : le mandat. La France obtint le mandat sur le Liban et la Syrie, la Grande-Bretagne celui sur la Palestine, selon les accords de partage dits de Sykes-Picot conclus secrètement le 16 mai 1916.
En prévision du partage de l’Empire, une délégation libanaise de notables (formée des 4 principales confessions, maronite, druze, sunnite et chiite) se rend immédiatement à Paris pour demander l’élargissement des frontières du Mont-Liban afin de rendre le pays économiquement et socialement viable.
Cette délégation demande l’intégration de la plaine de la Bekaa, et celle des ports de Tripoli, Saida et Tyr dans la région du Mont-Liban. Cette formule est finalement acceptée et adoptée. Le 1er septembre 1920 à la Conférence de San Remo le Grand-Liban remplace le Mont-Liban des Moutasarrif. Puis le 23 mai 1926 naît la République Libanaise avec la 1ère Constitution, dans les frontières plus ou moins actuelles du Liban d’aujourd’hui.
Le mandat est une forme de protectorat, une sorte de colonialisme « civilisé » où les prérogatives politiques, militaires ou économiques ne pouvaient être du ressort des « protégés ». Ces derniers ne pouvaient gérer que leurs affaires courantes ou administratives, et encore, sous la houlette de la puissance mandataire et par des administrateurs agréés par celle-ci, sinon nommés directement (comme la Direction des Chemins de fer, la Société des Eaux, de l’Electricité, des Douanes, etc.).
Mis à part ces Services Publics (appelés à l’époque Services Généraux), la France développa un système de gestion politique entièrement sous sa direction. Il est vrai que le Liban devint une République, avec un Président, un Gouvernement, un Parlement et d’autres institutions.
Mais au-dessus de tout cela il y avait le « monarque », le Haut-Commissaire, représentant la puissance coloniale, mandataire, désigné par la France (puisque le Liban échoua à la France), qui était le chef suprême – et absolu – au Liban, remplaçant le Moutasarrif. (11 Haut-Commissaires et 10 Présidents se succédèrent jusqu’en 1943).
Ce nouveau Liban, cette jeune République fut donc le résultat d’une nouvelle alliance, étonnante, qui se basait sur un fait non seulement économique, mais aussi politique. La montagne avait besoin d’un accès à la mer pour assurer son accès direct au monde. La montagne et la mer avaient besoin de la plaine de la Bekaa, zone très fertile et riche en eau pour assurer sa nourriture. Ce dernier point est le résultat d’une mémoire collective de la famine provoquée par les Ottomans, quand ces derniers ont encerclé et formé un blocus de la montagne empêchant toute nourriture d’y arriver. En plus, il était plus simple aux habitants de la plaine de traverser la montagne (à l’ouest) pour vendre leurs produits que de traverser les déserts (à l’est). Et les habitants de la mer y voyaient l’avantage de la protection de la montagne, zone de refuge traditionnelle.
Avec l’accès à la mer un nouvel horizon s’ouvre vers le monde, cela permettait à la montagne de renforcer ses alliances, et avec la plaine, de ne plus mourir de faim. De plus les frontières devenaient défendables autant à l’Est (avec une montagne également, la chaîne de l’Anti-Liban) et à l’Ouest avec la mer.
Ainsi cette nouvelle alliance entre la montagne, la mer et la plaine fertile se forgea grâce à la complémentarité des fonctions et permit à chacune de ces zones, grâce à des moyens supplémentaires et de la nouvelle solidarité créée, de mieux défendre et sa région et sa fonction.
Encore une fois les notions non seulement d’indépendance, et d’autogestion, mais de survie économique devenaient les moteurs de l’évolution du système politique libanais.
Evidemment cette alliance ne se construisit pas aussi simplement que cela et ne constitua pas immédiatement un pays ou une nation comme avec une baguette magique.
Chaque zone voulut dominer l’autre. Les zones étaient habitées par des populations qui avaient une histoire et un passé différents. Les alliances précédentes ne disparurent pas du jour au lendemain comme par enchantement.
Suite à cet élargissement et afin de rompre avec ce riche passé, la France déplaça la capitale vers Beyrouth, qui n’était à cette époque qu’un petit port sans grande importance. Beyrouth devint petit à petit le vrai poumon économique et le centre politique de ce nouveau Liban. Il détrôna les villes côtières (Tripoli, Saïda et Tyr), même celles qui devinrent syriennes ou palestiniennes (comme Tartous ou Haïfa).
Les Français s’attellent à créer des institutions inspirées du modèle français républicain (évidemment), ainsi qu’une infrastructure liant les régions les unes aux autres. Le train, l’électricité, l’eau, les routes, la monnaie, l’armée, la police. Tout cela se mit en place, car les français voulaient unifier et coloniser les zones sous mandat.
Cette nouvelle entente fut tout de même tiraillée par les anciennes tensions confessionnelles que les Puissances Occidentales avaient entretenues durant la période ottomane. Les Français continuèrent de privilégier leur soutien aux Maronites, même s’ils firent des concessions importantes aux autres confessions. Les Maronites ne furent plus aussi omnipuissants qu’auparavant, même s’ils gardaient encore une large partie de leur pouvoir.
Les autres confessions, orthodoxes, druzes, sunnites et chiites, entre autres, acquirent petit à petit des nouveaux droits inaliénables aux dépens des Maronites et au profit de la construction de l’état.
Cependant, les mouvements indépendantistes, qui s’étaient constitués durant la période ottomane n’avaient pas disparu et ne considéraient certainement pas l’avènement du mandat comme l’aboutissement de leur lutte.
Indépendamment de leur appartenance confessionnelle, les dépassant, et avec une base élargie à la mer-montagne-plaine, ces mouvements continuèrent leur lutte jusqu’en 1943. Le Liban obtint son indépendance totale le 22 novembre de cette même année, une indépendance qui fut immédiatement reconnue par la SDN, qui disparut peu de temps après pour être remplacée par l’ONU, dont le Liban fut un des membres fondateurs en 1945.
Ainsi donc l’indépendance totale fut acquise après plus de 4 siècles de luttes constantes avec divers rebondissements. Toujours la même motivation. Cette fois-ci la notion de liberté s’ajouta aux motivations antérieures : liberté de croyance, liberté de penser, liberté de s’exprimer, liberté économique. De nouveau le « vivre-ensemble » l’emporte.
Le Liban est ainsi le premier pays arabe à devenir indépendant et à se libérer du joug des coloniaux et des puissances mandataires. Il servira de modèle et d’encouragement à tous les autres mouvements arabes qui suivirent la mouvance libanaise.
Cette indépendance fut le résultat d’une nouvelle alliance, cette fois-ci, éminemment politique. Elle fut confirmée par le Pacte National, qui est une entente (orale) entre les 2 grands courants politiques de l’époque, l’un axé vers l’Occident et l’autre axé vers les pays arabes. Les pro-occidentaux renoncèrent à leur intégration totale à la politique occidentale (à ce moment-là elle commençait à être américaine), tout en gardant l’ouverture vers le monde. Les pro-arabes renoncèrent à leur intégration totale dans l’espace arabe tout en gardant de fortes relations avec ces pays. Le Liban fut d’ailleurs un des membres fondateurs de la Ligue Arabe également en 1945.
C’est encore une fois la fusion entre la montagne (solidarité), la mer (ouverture vers le monde) et la plaine (traditionalisme et conservatisme) qui renforça considérablement les mouvements d’indépendance. D’ailleurs que de discours politiques, que de chansons populaires ont vanté et continuent de vanter « notre » plaine, « notre » montagne et « notre » mer (sahlouna, jabalouna wa bahrouna – سهلنا وجبلنا وبحرنا).
Chaque groupe comprit que sa survie dépendait de la consolidation de ce nouvel Accord, même s’il était imparfait.
Cette alliance politique perdure encore jusqu’à aujourd’hui.
Pourtant elle a subi de nombreuses attaques, et a survécu aux aléas politiques de la région :
La création d’Israël en 1948 ;
- Les diverses guerres israélo-arabes de 1948, 1956, 1967, 1973 (particulièrement la défaite de 1967) ;
- Les idéologies qui ont traversé le monde arabe : le pan-arabisme, le nassérisme, les frères musulmans, le socialisme, le baathisme, le wahhabisme ;
- Aujourd’hui les mouvances jihadistes et salafistes (dont Daech et al Qaeda) ;
Ainsi qu’à tous les coups qui lui ont été portés directement :
La 1ère mini guerre civile de 1958 ;
- La présence palestinienne importante depuis 1967 (avec les Accords du Caire en 1969 sur les Camps Palestiniens) ;
- La guerre civile de 1975 à 1989 ;
- La présence syrienne de 1976 à 2005 ;
- L’invasion israélienne de 1978 à 2000 ;
- Les 2 guerres libano-israéliennes de 1982 et 2006 ;
- Les bombardements continuels d’Israël contre le Liban depuis 1948 ;
- Maintenant, depuis 2011, le presque 1.5 millions de réfugiés syriens au Liban ;
- Et, aujourd’hui, l’absence d’un Président de la République depuis le 25 mai 2014.
Depuis 1516 et jusqu’à aujourd’hui, les institutions et l’état se construisirent, se mirent en place tant bien que mal. Une infrastructure se développa. Une société se façonna, différemment de tout son voisinage, basée sur les valeurs de diversité, de tolérance, de liberté, d’indépendance, de mixité.
Les nombreux et brutaux remous de la région (que je viens de citer) affectèrent le bon fonctionnement de ces institutions. Pourtant la société résista et continua d’évoluer, de se former, de s’éduquer, de voyager, de s’ouvrir au monde, d’être même à la pointe du progrès dans certaines branches.
Ces institutions fonctionnent encore aujourd’hui, il est vrai de manière assez clientéliste et avec beaucoup de corruption.
On a toujours besoin de permis pour construire. On paie des taxes et impôts, on doit présenter des bilans à l’état. Malgré tous les défauts du système, le pays fonctionne, les écoles, les hôpitaux non seulement éduquent et soignent les libanais, mais aussi le presque 2 millions de réfugiés sur le sol libanais (palestiniens, irakiens, syriens). Les routes sont plus ou moins entretenues, l’eau et l’électricité sont distribuées, il est vrai de manière irrégulière et inégale, mais les réseaux fonctionnent. Internet et le téléphone fonctionnent. Les aéroports, les ports, les douanes fonctionnent. Les banques et le système bancaire fonctionnent. Surtout la sécurité fonctionne.
Jamais dans l’histoire du Liban moderne (soit depuis 1920 resp. 1943), personne n’a réussi à détruire ces institutions. Des factions ont voulu, et réussi, à s’emparer d’une institution en la colorant de sa couleur politique, ou en la rendant tributaire du parti pour en faire un instrument de recrutement clientéliste, mais pas de l’annihiler.
Toutes les institutions ou presque sont actuellement colorées. Toutes sont corrompues, mais elles existent.
Tous les partis se sont plus ou moins répartis une part du pouvoir, il y a donc tacitement un partage du gâteau financier. Une certaine forme de « l’équilibre de la corruption » – si j’ose employer cette formule peu élégante – tient le pays ensemble.
Comme tout ce système est largement gangréné par la corruption, la société civile se met petit à petit à remplacer les institutions de l’état en proposant toutes sortes d’activités et de structures parallèles à celles de l’état. Ce qui fait que souvent, le citoyen doit payer doublement sa facture d’eau ou d’électricité.
C’est, évidemment, loin d’être l’idéal, mais ça marche.
C’est donc une société civile très dynamique, très active, pleine de ressources, qui pallie les lacunes de l’état en procurant à la société toutes sortes de prestations : les ONG pour la protection des réfugiés, l’éducation pour le code de la route, la protection de la nature, l’éducation des enfants, la santé des handicapés, les espaces verts, la qualité de l’eau, la culture, le théâtre, etc. Rien n’échappe à cette société civile. Sans elle, probablement, le pays aurait été différent. Or qu’est-ce qu’une société civile, sinon une volonté commune de construire et de bâtir ?
Finalement rien ne réussit à détruire l’état libanais. Rien ne modifia le principe fondateur de cette alliance, même si les adhérents à un camp ou à l’autre ne sont plus les mêmes.
Les indépendantistes gagnèrent les batailles en 1544, en 1860, en 1943 et aujourd’hui encore une ligne rouge est infranchissable, par consentement de toutes les factions libanaises, et, surtout, grâce à une volonté populaire, malgré les tentatives innombrables de la dépasser. Interdiction absolue de retourner à la guerre civile, empêcher par tous les moyens une détérioration sécuritaire.
Il y a donc une solidarité tacite entre les diverses factions (non seulement des dirigeants, mais aussi des dirigés) bien au-delà de leurs différences confessionnelles et partisanes. La montagne, la mer et la plaine ont bien compris que leur seule chance de survie était une alliance indéfectible, malgré leurs divergences d’opinion.
L’esprit d’indépendance, que ce soit vis-à-vis des Ottomans, des Puissances Occidentales, des Français, le souci d’autonomie, voire d’autarcie, l’autogestion, l’esprit général de rébellion contre les occupants, quels qu’ils soient, la soif de libertés (au pluriel) ont été – et sont toujours – les motivations profondes des mouvements populaires ou militaires des Libanais de longue date. L’esprit de solidarité de la diversité, voilà ce qui a forgé et façonné et continue de forger et de façonner ce petit pays. Une volonté intrinsèque d’apprendre, de construire et de bâtir.
Ce sont les idées qui ont, depuis le 16ème siècle, formé les partis ou les camps et non pas leurs croyances ! C’est la survie existentielle de ces camps qui les rend dépendant les uns des autres. En politique occidentale on appelle cela un gouvernement de coalition (comme en Suisse avec la formule magique ou en Allemagne avec la formule actuelle de gouvernement).
A chaque fois que des tentatives de contourner cette cohabitation des idées par une formule sur une base confessionnelle, cela a abouti à de sanglants conflits qui n’ont pu être résolus que par des solutions politiques et des accords entre diverses tendances bien au-delà des divergences confessionnelles.
Cela ne veut pas dire que les confessions ne sont pas un élément essentiel du pays, mais elles n’en sont ni l’élément fondateur ni la colonne vertébrale et certainement pas le moteur évolutif. Au contraire, les religions ont toujours prouvé que chaque fois qu’il a été question de les séparer ou de les opposer les unes aux autres, elles ont refusé cet état et ont réagi par l’aspect politique et non pas confessionnel.
Ainsi donc la formule libanaise, basée sur la cohabitation de la diversité d’opinions, qui ressemble étrangement à la formule magique suisse, peut être un modèle de gestion d’une population multi-confessionnelle, pour ne pas dire multi-culturelle.
C’est cela le Liban, une idée, un mythe fondateur, une formule qui a fait ses preuves depuis 1516 et qui s’est, à chaque difficulté, renforcé, amélioré. Il est difficilement destructible, même s’il a une apparente fragilité.
Le Liban, cette idée devenue un pays, est le fruit d’une volonté de vivre ensemble, d’un partage, même difficile, de valeurs, communes d’autonomie, d’indépendance et de libertés (au pluriel).
Cette notion de liberté et de fierté, issu de la mentalité de la montagne se reflète par l’esprit de solidarité et d’accueil, mais aussi par celui de rébellion.
Le Liban existe, non pas, parce qu’on l’a créé, mais parce que les Libanais, tous les Libanais, l’ont façonné et ont voulu qu’il existe et vive. Il a résisté à tous ses prédateurs et, j’espère et le pense, il continuera de résister. C’est sa raison d’être.
Merci.
Beyrouth le 2.10.15
La Conférence était organisée par l’Institut des cultures arabes et mediterranéennes – L’Olivier (ICAM)



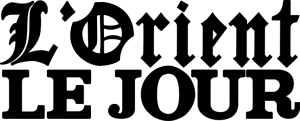
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.