58 MIN
L’âge d’or de la médecine arabe
En quoi la médecine arabo-islamique a-t-elle marqué l’histoire médiévale ? Comment expliquer l’hégémonie de l’Empire Arabo-islamique : sa civilisation, ses savoir-faire ? Alors que l’Occident traversait un long obscurantisme, comment cette science et cette médecine en sont venues à dominer le monde?
C’est peu dire que l’histoire des sciences, telle qu’elle nous est ici comptée, et telle que nous la racontons tous les jeudis est très largement occidentalo-centrée. Ainsi, l’histoire de la médecine dépeint très largement l’essor de la Renaissance à travers la redécouverte des textes antiques. Or, entre le Vème et le XVème siècle, pendant ces 1000 ans de l’âge d’or de la civilisation arabo-musulmane, les savants de langue arabe ne se sont pas contentés de « conserver les savoirs hérités de la Grèce et de la Rome antique ». Ils ont largement contribué à les développer, à la préciser voire à les réfuter. C’est cette histoire de la médecine arabe que nous allons aujourd’hui vous conter.
L’âge d’or de la médecine arabe : c’est le programme décentralisé qui est le nôtre pour l’heure qui vient. Bienvenue dans La Méthode scientifique.
Et nos deux narrateurs de cette autre histoire de la médecine sont aujourd’hui Danielle Jacquart, directrice d’études émérite à l’Ecole Pratique des Hautes Etudes, section sciences historiques et philologiques. Membre de l’Académie internationale de l’Histoire des Sciences et Bruno Halioua, dermatologue, enseignant d’histoire de la médecine à Sorbonne Universités, membre de la société française d’histoire de sciences.
Le reportage du jour
Rencontre avec Joël Chandelier, maître de conférence en histoire médiévale à l’Université Paris 8. Qui fut Avicenne et pourquoi son Canon a-t-il été imprégné l’histoire de la médecine orientale et occidentale du XIe au XVIIe siècle ? Par Antoine Beauchamp :
10 MIN
Quelques repères
- L’Empire arabo-islamique s’est considérablement étendu après la mort de Mahomet en 632. Un mouvement de conquête s’enclenche dans un premier temps sur la péninsule arabique, la Palestine, la Mésopotamie, la Perse et l’Egypte. En moins d’un siècle, l’empire arrive à s’étendre jusqu’au nord de l’Espagne à l’ouest, et au fleuve de l’Indus à l’est. Les grandes dynasties qui gouvernent et se succèdent vont instaurer une domination économique et intellectuelle.
- A la suite de l’effondrement de l’Empire romain, l’Occident va connaître une longue période d’obscurantisme scientifique. Dans le même temps, les nombreuses traductions des textes savants grecs vers l’arabe vont assurer une sauvegarde des connaissances en médecine. Au-delà d’une conservation des savoirs, les médecins arabes vont partir sur ces bases et commenter, critiquer et dépasser les théories prônées par les Anciens : Galien, Hippocrate.
- Entre le 10ème et le 13ème siècle, l’empire arabo-islamique est à son apogée et connaît un rayonnement scientifique, en particulier en médecine. Des savants comme Ibn Sina dit Avicenne, Muhammad Ibn Zakarya Râzi dit Rhazes, Abu al-Qasim al-Zahrawi dit Abulcasis dans des domaines tels que l’anatomie, la physiologie, les maladies infectieuses, la chirurgie et la pharmacie.
- Plus que des découvertes médicales, c’est une démarche rationnelle que les savants arabes vont instaurer, fondée sur l’observation et l’expérience, prémisses d’une médecine basée sur les faits, qui va actualiser et moderniser la médecine. Dans les grandes cités comme Bagdad, le Caire, La Mecque, Tolède ou Montpellier, des hôpitaux vont se bâtir et se développer pour accueillir tout profil de malade avec un système d’organisation sectorisé, où médecins, infirmiers, pharmaciens et étudiants œuvrent à la pratique et cultivent la théorie.
- A partir du 13ème siècle, plusieurs événements comme les invasions mongoles et les Croisades vont amorcer le déclin de l’Empire arabo-islamique. La science se poursuit cependant, et va circuler via les traductions vers le latin en Occident, et ainsi transmettre son héritage en théorie et pratique médicale, par des ouvrages comme le Canon d’Avicenne.
Le fil de l’émission
A retrouver sur le compte Twitter de La Méthode scientifique
- Abulcasis, grand maître de la chirurgie hispano-arabe médiévale (Medarus)
- Médecine grecque et médecine arabe : transmission du savoir entre Orient et Occident par Mehrnaz Katouzian-Safadi (CNRS – 2010)
- A la découverte de l’âge d’or des sciences arabes (DOSSIER – Université Libre de Bruxelles)
- Les sciences arabes : un âge d’or qui rayonne encore (AgroBioSciences – 2008)
- L’âge d’or de la médecine arabe (L’Histoire – 1985)
Les références musicales
Le titre du jour : “Andalusian suite for oud and orchestra: Granada” par Marcel Khalife
Le générique de début : « Music to watch space girls by », par Leonard Nimoy
Le générique de fin : « Says » par Nils Frahm

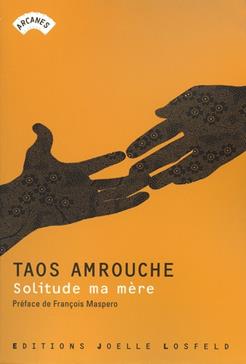
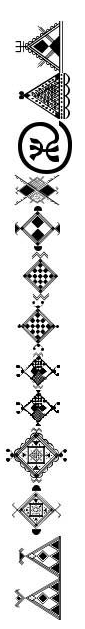
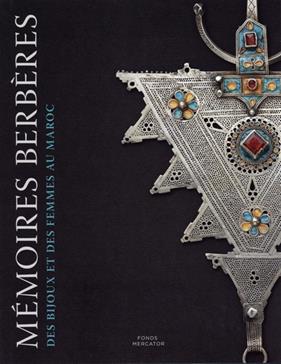

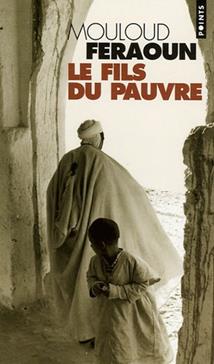

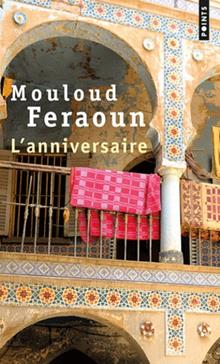
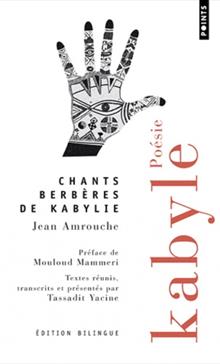
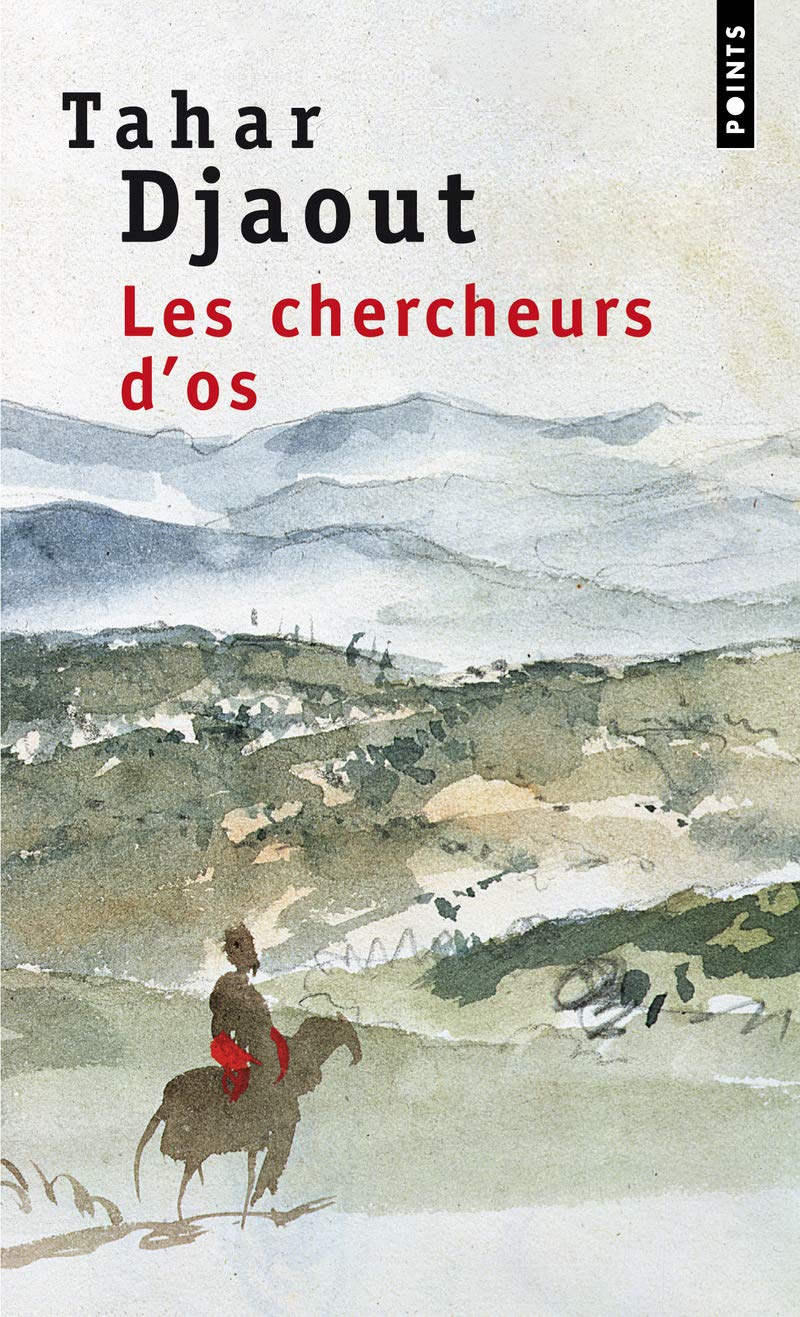
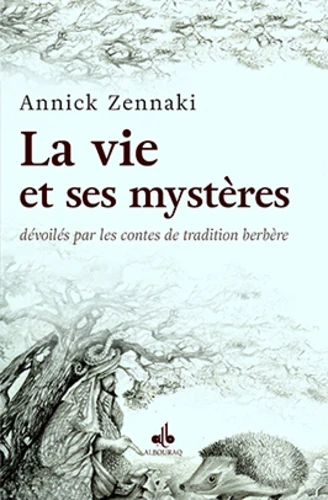
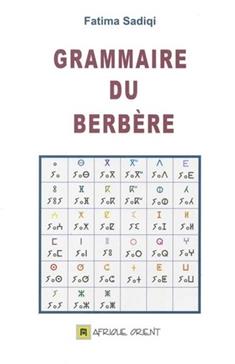
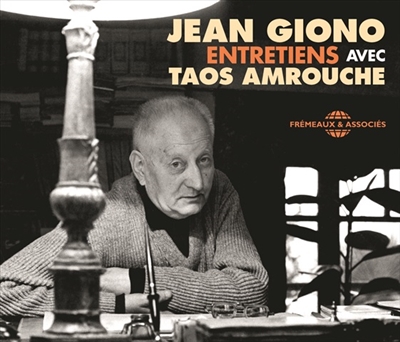
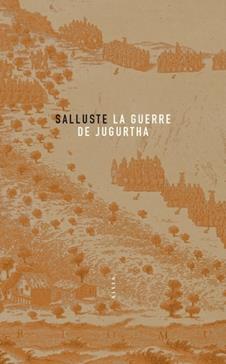
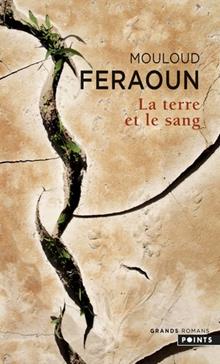
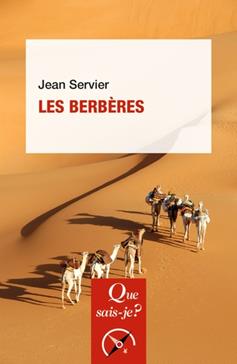
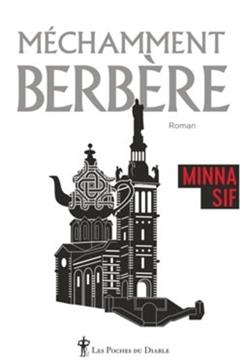
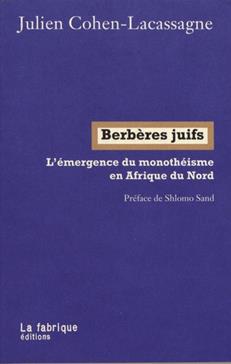
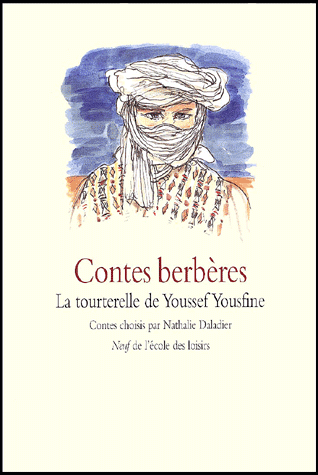
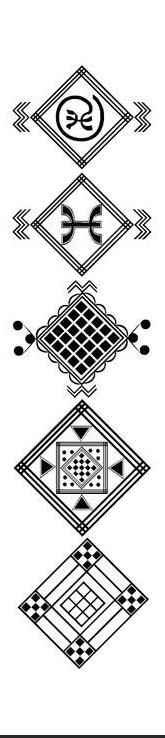
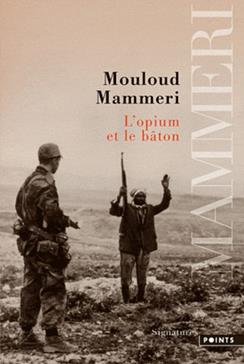

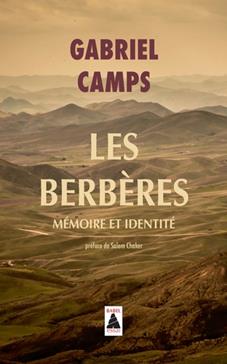

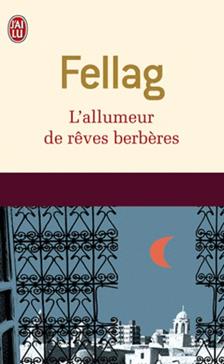
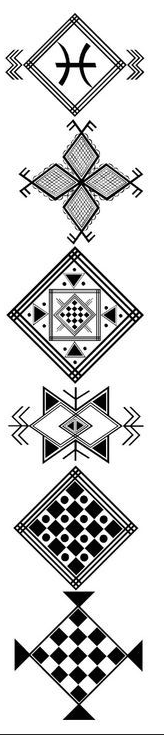
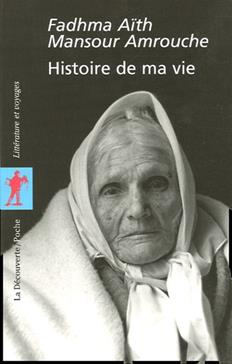
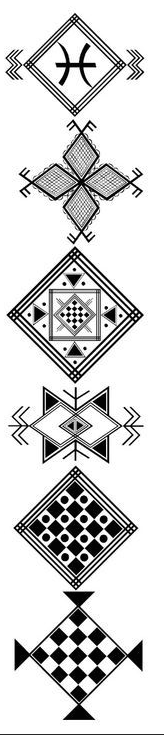
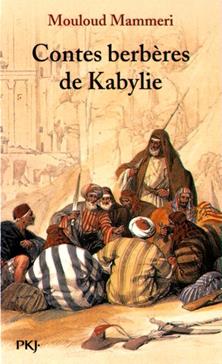

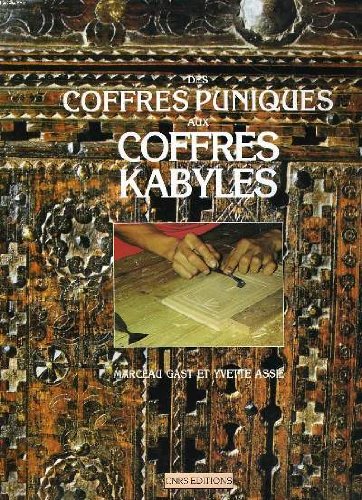





Vous devez être connecté pour poster un commentaire.