Etel Adnan et Simone Fattal : Cette pandémie exigerait plusieurs Guernica !
Confinées dans leur appartement parisien, les deux artistes multiculturelles, Etel Adan et Simone Fattal, ont accepté de partager leur expérience de cette situation inédite avec transparence, profondeur et humour.

« Le regard de la société ne m’a jamais gênée », affirme Etel Adnan, ici dans un portrait photo réalisé par Simone Fattal.

Pour Simone Fattal, photographiée par Etel Adnan, ce n’est pas le confinement en soi qui est le plus dur, c’est l’inquiétude. Photos DR
Par Propos recueillis par Josephine HOBEIKA, le 01 mai 2020 à 00h02
Dans quelle mesure ce confinement a-t-il eu un impact concret sur votre quotidien ?
Etel Adnan : Il n’y a eu presque pas de modification de mon quotidien. Vu mon âge bien avancé, j’avais du mal à marcher et j’utilisais une chaise roulante. Et cet hiver a été particulièrement froid à Paris. Je ne sortais plus. Mais je recevais beaucoup d’amis, et cela, dernièrement, s’est arrêté. C’est bien plus triste. Et savoir l’ampleur du sinistre fait mal à l’imagination. Je viens de faire un tour dehors, et c’est sinistre. Ça m’a rappelé le tremblement de terre de San Francisco, en 1990, quand tout un quartier de la ville s’était effondré et on se sentait dans un grand cimetière. C’était dur. Maintenant, c’est planétaire. C’est comme si la mort existait en tant que telle, et nous enveloppait. C’est sinistre.
Simone Fattal : Le confinement a changé toute l’organisation de la vie quotidienne, et dans mon cas aussi, mon travail personnel. Je travaille d’habitude dans mon studio, et je peux difficilement travailler ailleurs; cela dit, les artistes travaillent chez eux, et en période de création, ils ne sortent pas du tout. Donc ce n’est pas le confinement en soi qui est le plus dur, c’est l’inquiétude.
Quelles sont les bonnes et les moins bonnes surprises de ce confinement ?
S.F. : Une impression de vacances, un manque d’obligations. Avoir du temps à soi et en être le maître absolu, pas de date limite pour les projets, pas d’avion à prendre, quelle chance !
E.A. : Les médecins et les soignants ont été généreux, admirables. On ne les remerciera jamais assez. Mais on reprochera toujours aux gouvernements de ce monde, surtout ceux des pays riches, d’avoir réduit les budgets alloués à la santé, plutôt que ceux dédiés à l’armement, par exemple. À Paris, les services d’urgence dans les hôpitaux sont très déficients. Il va falloir tout reprendre en main.
Quel est l’impact de la pandémie sur votre création artistique et sur votre inspiration ?
E.A. : Dans mon cas, peu de choses ont changé. Il m’était déjà plus difficile d’écrire, ou même de lire, que de peindre. Parce que je suppose que la couleur donne de l’énergie et permet le travail, alors que les mots sont plus lourds à porter. En ce moment, je peins autant que possible. Au ralenti, bien sûr.
S.F. : Il est certain qu’on s’inquiète beaucoup, non seulement pour le présent, mais pour le futur. Comment va-t-on s’en sortir ? Les retombées économiques, au niveau mondial, vont se faire cruellement sentir à la rentrée. Car pour l’été, je crois que les gens vont partir en vacances, à moindres frais bien sûr, mais quand même. Les vraies difficultés vont se faire sentir en septembre. On prévoit une grande récession, beaucoup de chômage, cela va être très difficile pour tout le monde.
Ces dernières semaines, je fais des collages ; il m’est impossible de faire de la céramique ici, en appartement, ou même de la peinture. Le moment présent entre toujours dans mes collages, même si c’est indirect. Je leur trouve en effet un air différent de ceux que je faisais récemment.
Quel lien peut-il exister entre une crise de l’ampleur de celle que nous vivons, et la création artistique en général ?
S.F. : J’ai été interrompue en plein travail. J’avais entrepris des projets en Italie dans des ateliers, ces travaux ont dû être arrêtés, j’espère qu’ils ne seront pas perdus. Dans ce sens, cela me rappelle la guerre civile au Liban, où nous n’arrivions plus à travailler, avec les bombes, les pénuries. Ici aussi on manque de matériel, on manque de repos et on ressent beaucoup d’angoisse et d’incertitude concernant l’avenir, pas seulement le nôtre, mais celui du monde. Il va changer : cette énorme machine à dépenser s’est arrêtée. En ce sens, c’est une bonne chose, mais on aimerait voir la vie reprendre d’une façon mesurée, et dépenser les ressources du monde plus raisonnablement. C’est un vœu.
E.A. : On verra dans les temps qui viennent comment les artistes vont répondre à la pandémie que nous vivons !
Si vous deviez représenter artistiquement la pandémie mondiale que nous vivons, comment feriez-vous ?
E.A. : Cette pandémie exigerait plusieurs Guernica ! D’ailleurs, l’état du monde était terrible, et les artistes ne semblaient pas s’en soucier suffisamment. Prenez les guerres dans le monde arabe et la destruction des trésors d’architecture par la coalition saoudienne au Yémen, ou la menace du président des États-Unis de détruire les sites culturels de l’Iran. Où sont les artistes qui ont réagi ? Il y a trop d’argent dans le monde de l’art, et rien ne bouge, il n’y a pas de contestation.
S.F. : Représenter la pandémie, c’est compliqué ; un problème souvent se laisse voir avec le temps et pas sur le moment, ou du moins on le ressent différemment.
Quel impact cette existence confinée a-t-elle sur votre couple ? Avez-vous modifié votre répartition des tâches à la maison ?
E.A. : Quand on n’a pas d’aide, c’est Simone qui cuisine, et on cuisine libanais autant que possible. Je ne suis pas capable de vraiment aider.
S.F. : Je cuisine souvent, mais des choses simples, sauf hier où j’ai fait des choux farcis. Le jour de Pâques, j’ai préparé un merveilleux gigot, et plus récemment, des souris d’agneau à la damascène, c’est-à-dire à la mélasse de grenade ; parfois ce sont des soupes, des salades, des œufs au plat au sumac, ou une boîte de thon, un délice ! Nous sommes livrées régulièrement en fruits et en légumes, donc on ne manque de rien.
S.F. : La première chose que j’aurais envie de faire, à part aller en Bretagne, nager et voir la mer, ce serait de reprendre mes projets interrompus, dans les deux ateliers de céramique.
E.A. : Je n’ai pas beaucoup de projets. Quand ce sera fini, j’aimerais pouvoir aller en Bretagne, respirer mieux, voir l’océan. J’aimerais maintenir dans mes conversations mes soucis pour l’écologie, et pour ce qui se passe au Liban, surtout. Les buts des manifestations au Liban n’ont pas été atteints. Il faut rester vigilants jusqu’à ce que justice soit rendue : les ex-politiciens se pavanent librement, ils n’ont pas été traduits en justice, ils se recyclent en « opposants », ils n’ont même pas honte. Or ce sont des criminels de grande envergure. Par exemple, les responsables de la crise des déchets se promènent en toute impunité et rêvent d’un avenir politique en ce même pays, comme si de rien était, alors que l’immunité collective des Libanais a bien baissé à cause de leurs vols et de leurs détournements de fonds ! On pourrait même dire que la pollution a déjà aidé à créer une épidémie de cancers. Nous, Libanais de tous bords, qu’allons-nous faire ? Commencer par aider notre nouveau gouvernement à agir sur ce plan…
Vous avez évolué toute votre vie dans des contextes pluriculturels, comment avez-vous choisi Paris finalement ?
S.F. : Nous avons choisi Paris parce que nous y avions un appartement depuis bien longtemps. Paris est finalement un très bon choix. La Californie est belle, et la vie y était très agréable, mais elle est excentrique. La France a le meilleur système de communications, non seulement à l’intérieur de ses frontières, mais pour l’Europe en général. Elle est au cœur de l’Europe. Paris est la plus agréable des grandes villes, et pour les Libanais, elle est comme une mauvaise habitude.
E.A. : Je n’ai pas vraiment choisi Paris. Il y a à peu près sept ou huit ans, j’ai pris l’avion jusqu’à Berlin, et au bout du voyage, j’ai eu de sérieux problèmes de confusion. Le médecin m’a dit que souvent, à partir de 75 ans, des gens pouvaient souffrir des voyages en avion, cela pouvait gêner des mécanismes cérébraux. Il m’a déconseillé de reprendre l’avion. Comme je me trouvais à Paris et que l’appartement était disponible, nous y sommes restées. J’aurais préféré être obligée de rester en Californie, ou au Liban. Bien que Paris ne soit pas à bouder, ou à regretter, la ville reste fabuleuse.
Comment ressentez-vous le regard de la société sur le couple de femmes que vous formez, selon les pays que vous connaissez bien (essentiellement la France, le Liban et les États-Unis) ?
S.F. : Nous avons eu énormément de chance. Nous n’avons jamais eu de problèmes, et avons été acceptées d’emblée dès le premier jour, au Liban et ailleurs, probablement parce que nous n’avons jamais eu l’ombre d’une indécision à cet égard. Nous avons commencé à vivre ensemble, et les gens l’ont accepté ; ce qu’ils en ont pensé par devers eux, nous ne l’avons jamais su. Bizarrement, on me demande souvent, aujourd’hui, comment j’ai fait pour vivre aussi ouvertement avec une femme. À l’époque, on ne m’a pas posé la question.
E.A. : Le regard de la société ne m’a jamais gênée. Être considérée comme « artiste » a dû beaucoup aider. C’est surtout aux États-Unis, un pays violent dans ses réactions, que j’ai vu des gens souffrir le plus d’une homophobie presque généralisée, qui a souvent poussé ses victimes au suicide. En France, on est en pays civilisé, ouvert, on s’attend presque à ce que les artistes aient un comportement considéré comme excentrique. Le Liban a une vieille sagesse qui, dans la pratique, le rend permissif. Je me souviens encore des visites que faisait ma mère à une amie à elle dont le fils, « le chapelier Georges », était souvent fardé, et amoureux du coiffeur Antoine. Et ces dames étaient pleines d’attendrissement pour le jeune couple ! Au pire, on les trouvait ridicules.

RETROUVEZ L’ARTICLE ORIGINAL SUR LE SITE DE L’ORIENT LE JOUR
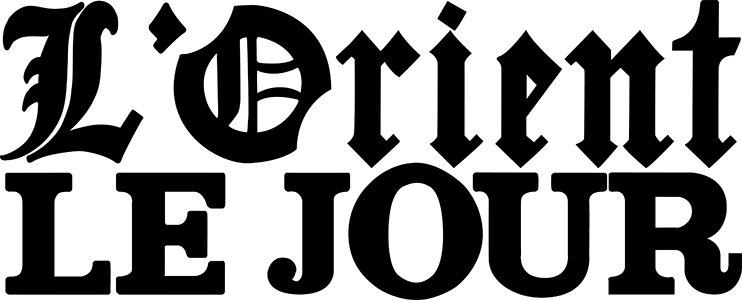






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.