Le terrible sinistre qui vient de frapper Beyrouth et a endeuillé le Liban est intervenu alors que le pays traversait déjà un moment des plus sombres de son histoire, pire que celui qu’il a connu lors de la guerre civile de quinze ans. Trente ans se sont écoulés depuis cette tragédie sans qu’il soit remédié aux maux qui l’ont provoquée. Bien au contraire, ces maux se sont aggravés, à cause d’une part des ingérences étrangères impliquant des puissances régionales ou de grandes puissances, et de l’autre de la monopolisation du pouvoir par les leaders des groupes confessionnels, qui ont toujours considéré le pays comme un butin de guerre.
Le 17 octobre de l’an dernier a vu le déclenchement d’un mouvement de protestation exceptionnel, une première dans l’histoire contemporaine du Liban. C’est qu’il a réussi à transcender tous les clivages : confessionnels, idéologiques, régionalistes ou partisans. Des dizaines de milliers de participants, la jeunesse en tête, ont exprimé avec force le besoin d’un changement radical des mœurs politiques et l’arrêt de la dilapidation des biens publics. Ils ont réclamé aussi la mise à l’écart de la classe dirigeante honnie qui a soumis le pays à une tension permanente, l’a entraîné dans des conflits hors de ses frontières et réduit l’État à la portion congrue, le rendant incapable d’agir ne serait-ce que pour assurer des tâches élémentaires comme la distribution de l’eau, de l’électricité ou le ramassage des ordures.
Dans la foulée de ce mouvement de protestation, une Charte de salut national a été récemment rendue publique. Initiée par un grand nombre d’activistes du mouvement social, d’écrivains et d’intellectuels, elle appelle à la recomposition du champ politique et à la création d’une vaste coalition ayant pour tâche l’édification d’un État de droit, démocratique, garantissant les principes d’égalité et de justice sociale.
Avec l’effondrement du système économique, la rétention par les banques de l’argent des déposants, la régression de la situation sociale, culturelle, l’apparition de la pénurie alimentaire, le Liban ne se trouve pas seulement au bord du gouffre, il est menacé dans sa propre existence.
L’effondrement du Liban aura, à n’en pas douter, de lourdes conséquences sur tout le Proche-Orient. Il signifiera la chute du dernier bastion du pluralisme, de la diversité et de l’ouverture dans cette région du monde. Il sonnera aussi la fin du rôle de pont entre l’Orient et l’Occident que le Liban jouait, de poumon qui permettait dans le monde arabe à la culture et à l’idée de démocratie de s’oxygéner. Le Liban de la création, de la liberté d’expression, du refus de l’obscurantisme et de la pensée unique, le Liban qui s’est engagé résolument dans le projet de modernité et s’est mis en situation de dialoguer d’égal à égal avec les autres cultures, ce Liban des lumières est de nos jours menacé de mort. Sa disparition signifierait l’extension de l’aire de l’intolérance, de l’oppression, de la terreur et des pulsions communautaristes incontrôlables.
Nous Libanais ou, de par le monde, amoureux du Liban, affirmons ici notre refus de nous résigner à une telle perte.
Aujourd’hui, nous nous inclinons devant toutes les victimes de la catastrophe du 4 août et nous nous associons au deuil de leurs familles. Et pour que la vie ait le dernier mot, nous exprimons notre soutien total au mouvement de la société civile qui va continuer à se battre pour un nouveau Liban où il redeviendra possible d’établir un véritable État de droit, libéré du carcan confessionnel, garantissant à tout un chacun les droits et les libertés d’une citoyenneté pleine et entière.
Et que vive le Liban des Lumières !
Ce texte, à l’initiative des deux écrivains Abdellatif Laâbi et Issa Makhlouf, a recueilli l’adhésion de près de 150 créateurs et intellectuels du monde entier, et reste ouvert aux signatures à l’adresse suivante : sosliban1@gmail.com (en précisant : nom, prénom, profession, nationalité).
Premiers signataires :
Mohammed Ismaïl Abdoun (universitaire, Algérie) ; Ahmed Abdul Hussein (poète, Irak) ; Sabah Abouessalam Morin (sociologue, Maroc) ; Yassin Adnan (écrivain, Maroc) ; Anissa Ahmad Fakhro (écrivaine, Bahreïn) ; Ayad Ahram (enseignant, France) ; Yumna Aïd (critique littéraire, Liban) ; Younès Ajarraï (acteur culturel, Maroc) ; Yacoub Youssef Al-Muharraqi (écrivain, Bahreïn) ; Ali Al-Muqri (romancier, Yémen) ; Budoor Al-Riyami (peintre, Oman) ; Ghani Alani (calligraphe, Irak) ; Brahim Alaoui (muséologue, Maroc) ; Ammiel Alcalay (écrivain, Etats-Unis) ; Zineb Ali-Benali (universitaire, Algérie) ; Antonio Alvarez de la Rosa (professeur, Espagne) ; Ali Anouzla (journaliste, Maroc) ; Asaad Arabi (peintre, Liban) ; Aïcha Arnaout (poétesse, Syrie/France) ; Sayf Arrahbi (poète, Oman) ; Assadour (peintre, Liban) ; Akl Awit (poète, Liban) ; Liana Badr (écrivaine, Palestine) ; Najwa Barakat (romancière, Liban) ; Faraj Bayrakdar (poète, Syrie/Suède) ; Chawki Bazih (poète, Liban) ;Yussef Bazzi (écrivain, Liban) ; Amina Bekkat (universitaire, Algérie) ; Nadir Bekkat (avocat, Algérie) ;Tahar Bekri (poète, Tunisie) ; Tahar Ben Jelloun (écrivain, Maroc) ; Ali Bencheneb (universitaire, Algérie/France) ; Barbara Benini (universitaire, Italie) ; Anouar Benmalek (écrivain, Algérie/France) ; Sabiha Benmansour (universitaire, Algérie) ; Fethi Benslama (psychanalyste, France/Tunisie) ; Reda Bensmaia (universitaire, Algérie/États-Unis) ; Abdelkader Benyacoub (psychiatre, Algérie) ; Belkacem Benzenine (chercheur, Algérie) ; Afifa Bererhi (professeur, Algérie) ; Anne-Emmanuelle Berger (universitaire, France) ; Mohammed Berrada (écrivain, Maroc) ; Sophie Bessis (historienne, Tunisie/France) ; Abbas Beydoun (poète, Liban) ; Nabil Beyhum (sociologue, Liban/France) ; Mahi Binebine (peintre, Maroc) ; Inam Bioud (enseignante, Algérie) ; Mustapha Boutadjine (plasticien, Algérie) ; Leandro Calle (poète, Argentine) ; Aissa Cheriet (romancier, Algérie) ; Jeannette Chidraoui Doueihi (professeure, Liban) ; Hélène Cixous (écrivaine, France) ; Francis Combes (poète, France) ; Hind Darwish (éditrice, Liban) ; Zahida Darwish (universitaire, Liban) ; Christophe Dauphin (écrivain, France) ; Antoine Douaihy (écrivain, Liban) ; Jabbour Douaihy (romancier, Liban) ; Dominique Eddé (écrivaine, Liban) ; Abderrahim El Allam (écrivain, Maroc) ; Abdel Rahman El Bacha (musicien, Liban) ; Youssouf Amine Elalamy (écrivain, Maroc) ; Martine Erhel (comédienne, France) ; Lily Farhoud (historienne d’art, Liban) ; Hafid Gafaïti (universitaire, Algérie) ; Katia Ghosn (universitaire, Liban/France) ; Nasser Eddine Ghozali (universitaire, Algérie) ; Abdallah Habib (écrivain, Oman) ; Qassim Haddad (poète, Bahreïn) ; Toufoul Haddad (photographe, Bahreïn) ; Lyas Hallas (journaliste, Algérie) ; Olivia C. Harrison (universitaire, États-Unis/France) ; Nancy Huston (écrivaine, Canada/France) ; Joseph Issaoui (poète, Liban) ; Hussam Itani (journaliste, Liban) ; Jana Jabbour (universitaire, Liban) ; Jean Jabbour (universitaire, Liban) ; Hana Jaber (chercheuse, Liban) ; Nuno Judice (écrivain, Portugal) ; Inaam Kachachi (écrivaine, Irak) ; Mohammed Kali (journaliste, Algérie) ; Marlène Kanaan (universitaire, Liban) ; Abdellah Karroum (critique d’art, Maroc) ; Kamel Kateb (démographe, France/Algérie) ; Salam Kawakibi (politologue, Syrie) ; Naget Khadda (universitaire, Algérie) ; Amine Khene (poète, Algérie) ; Gisèle Khoury (journaliste, Liban) ; Nidaa Khoury (universitaire, Haïfa) ; Vénus Khoury-Ghata (écrivaine, Liban/France) ; Hussein Kneiber (journaliste, Liban/France) ; Abdellatif Laâbi (écrivain, Maroc/France) ; Lazhari Labter (écrivain, Algérie) ; Werner Lambersy (poète, Belgique) ; Fouad Laroui (écrivain, Maroc) ; Bernabé Lopez Garcia (universitaire, Espagne) ; Charif Majdalani (écrivain, Liban) ; Touria Majdouline (poétesse, Maroc) ; Issa Makhlouf (écrivain, Liban/France) ; Alia Mamdouh (romancière, Irak) ; Kedidir Mansour (politologue, Algérie) ; Mohammed Mansouri Idrissi (plasticien, Maroc) ; Farouk Mardam-Bey (éditeur, Syrie) ; Benamar Mediene (universitaire, Algérie) ; Faika Medjahed (psychanalyste, Algérie) ; Mohamed Melehi (peintre, Maroc) ; Luis Mizon (poète, Chili) ; Wajdi Mouawad (dramaturge, Liban) ; Edgar Morin (philosophe, France) ; Julie Mourad (écrivaine, Liban) ; Jean Mouttapa (éditeur, France) ; Mostapha Naaman (diplomate, Yémen) ; Shams Nadir (écrivain, Tunisie) ; Alexandre Najjar (écrivain, Liban) ; Nabil Naoum (romancier, Égypte) ; Mohamad Nassereddine (poète, Liban) ; Hassan Nejmi (écrivain, Maroc) ; Mohamed Fadel Obaidli (écrivain, Bahreïn) ; Pierre Oster (poète, France) ; Ali Oumlil (diplomate, Maroc) ; Fatma Oussedik (sociologue, Algérie) ; Jean Portante (écrivain, Luxembourg) ; Roshdi Rached (CNRS, France/Égypte) ; Maria Ramirez Delgado (universitaire, Venezuela) ; Wadih Saadé (poète, Liban/Australie) ; Abdelhadi Saïd (poète, Maroc) ; Fatiha Saïdi (sénatrice honoraire, Belgique) ; Noureddine Saïl (philosophe, Maroc) ; Amine Saleh (écrivain, Bahreïn) ; Christian Salmon (écrivain, France) ; François Salvaing (écrivain, France) ; Paz Sanchez Perez (professeur, Espagne) ; Mohamed Sari (universitaire, Algérie) ; Habib Selmi (romancier, Tunisie) ; Leïla Shahid (diplomate, Palestine) ; Jean-Pierre Siméon (poète, France) ; Leïla Slimani (écrivaine, France/Maroc) ; Hinde Taarji (journaliste, Maroc) ; Hocine Tandjaoui (écrivain, France) ; Habib Tengour (écrivain, Algérie) ; André Velter (poète, France) ; Teresa Villa-Ignacio (universitaire, États-Unis) ; Abdourahman A. Waberi (écrivain, Djibouti/France) ; Abdo Wazen (poète, Liban) ; Yahia Yakhlef (romancier, Palestine) ; Samar Yazbeck (romancière, Syrie) ; Amin Zaoui (écrivain, Algérie) ; Mahmoud Zibawi (universitaire, Liban) ; Abdallah Zniber (militant associatif, France/Maroc).


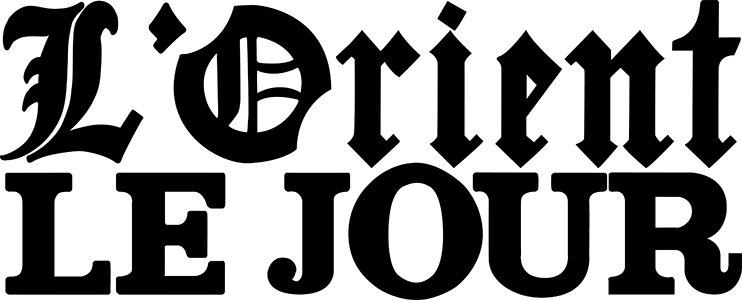






Vous devez être connecté pour poster un commentaire.