Antoine Oury – 29.12.2017
Le programme de la prochaine édition du Festival international de la bande dessinée d’Angoulême se dévoile petit à petit : parmi les expositions organisées cette année, « Nouvelle génération » se penchera sur les jeunes auteurs de la bande dessinée arabe d’aujourd’hui. Une exposition inédite au musée de la bande dessinée d’Angoulême, du 25 janvier au 4 novembre 2018.
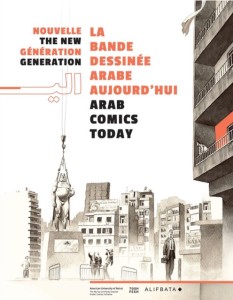
Algérie, Égypte, Irak, Jordanie, Liban, Libye, Maroc, Palestine, Syrie, Tunisie… Une cinquantaine d’auteurs arabes seront mis à l’honneur dans une grande exposition organisée au musée de la bande dessinée d’Angoulême, dès le 25 janvier prochain. Après le 4 novembre et la clôture de l’expo à Angoulême, les œuvres se déplaceront dans d’autres villes d’Europe pour participer à la découverte de cette bande dessinée arabe foisonnante.
« Nous fêtons cette année sept ans d’efforts continus pour promouvoir, exposer et publier des caricaturistes et auteurs de bande dessinée arabes originaires du Moyen-Orient, du Golfe et de l’Afrique du Nord. Nous y sommes arrivés grâce à la Mu’taz and Rada Sawwaf Comics Initiative et l’Université américaine de Beyrouth, ainsi qu’à la maison d’édition Tosh Fesh », indique Mu’taz Sawwaf, fondateur de la Sawwaf Arab Comics Initiative à l’université américaine de Beyrouth.
L’enjeu est évidemment de faire connaître la bande dessinée arabe et, ainsi, de soutenir son développement. « Cette initiative vise à encourager la recherche interdisciplinaire sur la bande dessinée arabe, à promouvoir la production, la formation scolaire et universitaire, mais aussi l’enseignement sur et de la bande dessinée. Elle prévoit de développer un fonds de bandes dessinées arabes et de se charger de sa maintenance, tandis que Tosh Fesh se consacre à la publication d’anthologies de caricaturistes et d’auteurs de bande dessinée de la région » poursuit Sawwaf.
« Cette aventure formidable a démarré à l’occasion de plusieurs visites de Jean-Pierre Mercier et moi-même au Caire à l’invitation du festival CairoComix, à Beyrouth pour les Mahmoud Kahil Awards, au Maroc pour le festival de bande dessinée de Tétouan porté par l’Institut National des Beaux Arts, en Tunisie », raconte Pierre Lungheretti, directeur général de la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image.
Déployée dans trois salles du musée de la bande dessinée, l’exposition Nouvelle génération la bande dessinée arabe aujourd’hui se présente comme une promenade géographique, à la fois didactique et rêveuse. Elle met en avant les collectifs d’auteurs, fers de lance du renouveau de la bande dessinée arabe contemporaine.

Entre papier et palette graphique, cette nouvelle génération ne choisit pas ; l’exposition montre des originaux encadrés aussi bien que des pages consultables sur tablettes et/ou écrans interactifs. La scénographie met en avant les interprétations graphiques des décors dans lesquels les auteurs évoluent, au premier rang desquels les décors urbains, omniprésents dans leurs productions.
Comptant nombre de femmes dans ses rangs, cette vague d’artistes arabes trentenaires est souvent constituée en collectifs (Samandal au Liban, TokTok en Égypte, Skefkef au Maroc, Lab619 en Tunisie…), même si quelques solitaires travaillent aussi dans leur coin. Regroupant les auteurs membres des collectifs, l’exposition est l’occasion également de découvrir les créateurs solitaires.
Un parcours enfants permet aussi aux plus jeunes de se familiariser avec cette production nouvelle, ouverte à toutes les influences des traditions étrangères, mais aussi des arts de la rue, de la télévision, des jeux vidéo…
L’exposition « Nouvelle génération : la bande dessinée arabe aujourd’hui » est une coproduction la Cité internationale de la bande dessinée et de l’image, the Mu’taz & Rada Sawwaf Arabic Comics Initiative/ToshFesh.com, l’Université américaine de Beyrouth, l’institut français de Paris, en lien avec les Instituts français de la région monde arabe.
Retrouvez l’article sur la page de Actua litté

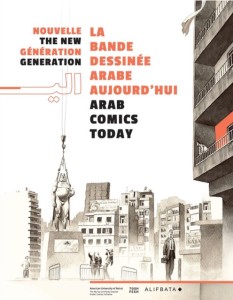


Vous devez être connecté pour poster un commentaire.