
Quelles sont les conséquences de la guerre sur la création culturelle au Yémen ?
Ali al-Muqri : Chez les Arabes, on pense souvent que les tragédies suscitent la création. Mon expérience des débuts du conflit au Yémen me confirme qu’au contraire, la guerre étouffe la création. Comment l’écrivain peut-il écrire pendant qu’il entend les explosions de bombes et de missiles, qu’il entend les cris d’une famille dont la maison a été détruite, qu’il est sans électricité, sans approvisionnement en eau et en nourriture, et qu’il ne touche plus de salaire ?
Vous avez longtemps été journaliste. Quelle est la situation actuelle de la presse yéménite ?
Le Yémen a vécu un « printemps de la presse » après l’unification entre le Sud et le Nord en 1990 et jusqu’à la guerre civile de 1994. Après cette date, la presse est devenue contrefaite et les critiques qui s’y exprimaient n’étaient plus fondées sur des sources dignes de foi. Des journaux pouvaient certes critiquer la corruption, mais si des journalistes publiaient des documents ou des informations attestant de son ampleur et dévoilant l’identité des corrompus, ils allaient en prison.
Après la prise de Sanaa par les Houthis en 2014 et le déclenchement de la guerre en 2015, la plupart des entreprises de presse ont été fermées et seuls trois quotidiens existent encore. Le pouvoir rebelle a emprisonné, enlevé et tué des dizaines de journalistes. Certains d’entre eux sortent de prison en état d’agonie juste avant de mourir. Avec la multiplication de milices islamistes – qu’elles soient houthies, issues des Frères musulmans ou salafistes – ou de celles relevant du Conseil de transition du Sud à Aden, les journalistes ne peuvent plus exercer leur métier. Beaucoup ont eu recours aux réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, mais ceux-ci sont la scène de multiples opérations de déformation des faits et de manipulation du public pour dresser des écrans de fumée devant une réalité insupportable.
Votre roman L’encens d’Aden (2014, non traduit) relate l’histoire d’un Français qui quitte Paris pour se réfugier à Aden. Avec ce thème, menez-vous une réflexion sur ce que signifient la nation et la quête d’une appartenance nationale ?
Ce roman est une prolongation de ce thème, mais sous l’angle d’un questionnement sur la possibilité de trouver une alternative à la patrie. Un personnage du livre, un Français, quitte Paris durant la Seconde Guerre mondiale pour trouver une échappatoire aux obligations de l’engagement patriotique requises par la situation de la France durant l’occupation allemande (1940-1944). Il rejoint Aden où il peut se fondre dans une société hétérogène et où personne ne lui demande rien. Il raconte sa vie à des personnes appartenant à une société multiculturelle composée d’individus venant de partout et dans laquelle se retrouvent des musulmans, des chrétiens, des juifs, des hindous, des bouddhistes, des athées, etc. Le commerçant français Antonin Besse (1877-1951) était un entrepreneur renommé à Aden.
Le Français du roman vit les transformations de la ville dans les années 1940, 1950 et 1960. Durant cette période émerge la question de savoir qui est Adénite et de définir qui possède le droit à l’« identité nationale » dans cette ville. Durant les dernières années de l’occupation britannique (1872-1967), le pouvoir a reconsidéré les identifications des habitants. Des critères ont ainsi été établis pour définir qui était Adénite. Certains ont revendiqué une citoyenneté exclusive avec le slogan « Aden pour les Adénites », tandis que d’autres ont mis en avant la yéménité de la ville, son appartenance à la nation arabe ou insisté sur son caractère islamique. Après l’indépendance du Yémen du Sud en 1967, de nombreux habitants quittèrent la ville du fait qu’elle avait perdu, à leurs yeux, la qualité de patrie alternative. Cet immigré français ressentit le même sentiment de perte.
Le thème de la discrimination que subissent certains groupes sociaux parcourt Saveur noire, odeur noire (2008, non traduit) et Le beau Juif. De quelle manière avez-vous abordé cette question dans votre œuvre ?
J’ai abordé ce problème sous un angle littéraire. Dans ces deux romans, j’ai voulu traiter à bras-le-corps des discriminations auxquelles sont confrontées certaines catégories sociales marginalisées au Yémen, non pas en soulignant les conditions nécessaires pour une vie commune harmonieuse, mais en m’interrogeant sur la notion même de patrie dans sa géographie, son histoire, voire sa langue. Pour certains personnages de ces deux romans, qu’ils soient juifs ou akhdam (Noirs yéménites), la nation n’existe pas comme idée ou comme réalité vécue, elle n’a aucun sens (1).
Quelles réactions a suscitées votre œuvre auprès des lecteurs yéménites et arabes, particulièrement avec L’alcool et le vin en islam (2007, non traduit) et Femme interdite ?
En rédigeant L’alcool et le vin en islam, j’ai voulu critiquer la mentalité religieuse qui considère toute chose comme interdite. J’ai alors fait des recherches dans le patrimoine culturel islamique et j’ai constaté qu’il y avait de fortes divergences concernant l’alcool parmi les premiers musulmans. Certains prônaient son interdiction, tandis que d’autres étaient partisans de sa libre consommation sous conditions.
La mentalité musulmane qui consacre l’interdiction de l’alcool depuis plus de mille ans et qui occulte et refuse les opinions divergentes est la même que celle qui a lancé des accusations d’apostasie contre moi dans les mosquées et les revues islamiques. Ces campagnes ont été conduites par un religieux et un ancien ministre d’Al-Awqaf (Biens de mainmorte) et de nombreuses menaces ont été lancées à mon endroit. Cela s’est répété après la parution de Femme interdite, qui relate la vie d’une femme parmi les djihadistes. Ces derniers ont lancé contre moi une campagne hostile et m’ont accusé d’apostasie. Ils s’en sont aussi pris à un universitaire nommé Ahmed al-Arami. Tout a commencé lorsqu’il a proposé à ses étudiants de l’université d’Al-Baïda d’étudier mon roman. Leurs parents s’en sont plaints à l’administration et ont demandé à ce qu’il soit démis de ses fonctions, ce qui a été fait. Al-Qaïda dans la péninsule Arabique (AQPA) a publié un communiqué enjoignant de tuer l’universitaire pour avoir prescrit la lecture d’un roman qui enfreint les règles et la morale islamiques selon ce qu’ils prétendent. Ahmed al-Arami dut fuir le Yémen et se réfugier au Caire. Ils se sont ensuite rendu compte que l’auteur du livre résidait toujours au Yémen et ils m’ont pris dans leur ligne de mire. Cet appel au meurtre ne cesse d’être relancé de temps à autre, même si je ne vis plus au Yémen.
Votre dernier roman, Le pays du Commandeur, est publié en France en mars 2020. De quoi parle-t-il ?
Il relate les derniers jours d’un dictateur arabe à travers l’histoire d’un écrivain à qui l’on demande de se rendre dans le « pays du Commandeur » pour participer à la rédaction d’une biographie à sa gloire. Son arrivée coïncide avec le déclenchement d’une révolte populaire réclamant la chute du régime. L’écrivain fait connaissance avec la fille du dictateur qui souffre d’un manque affectif et lui demande de l’épouser. Il fréquente aussi l’entourage du président et observe comment les gens interagissent entre eux alors que le tyran est sur le point d’être renversé, comme s’ils bénéficiaient d’un supplément de vie inespéré.
Les personnages de vos romans et les obstacles qu’ils rencontrent dans leurs tentatives de se réaliser et de s’affirmer ne symboliseraient-ils pas les difficultés culturelles du rapport à l’autre ?
La culture arabe et les sociétés islamiques se caractérisent par l’existence de tabous multiples. Une perception de l’autre, réductrice, nécessiterait d’être corrigée, du fait que les musulmans sont l’extension culturelle de leurs ancêtres juifs et chrétiens, et avant eux des idolâtres, des zoroastriens, des hindous, des Babyloniens, des Assyriens, des anciens Égyptiens… Ils se sont tous retrouvés sous le même ciel avant de se diviser en raison de l’expansion d’idéologies devenues héréditaires et qui créent des interdits et des tabous. Ainsi, tout a fini par relever du domaine de l’interdit, la terre, la patrie, les idées, et au lieu que tout le monde vive sur une terre pacifiée et dans une patrie partagée jouissant de la liberté d’expression, on vit dans le monde de l’illusion et de l’interdit, dans le pays du sacré et de la religion véritable.
Je ne vois pas en quoi une identité plurielle, sexuelle, ethnique ou idéologique serait problématique. Le problème réside dans une histoire de conflits accumulés pour définir ces identités et ses conséquences sur l’existence dans un présent dans lequel il est difficile de parler d’une seule identité sans considérer l’ensemble de ses relations avec les autres identités. L’Autre selon l’acception ancienne n’existe plus, et l’Autre est peut-être simplement nous. De fait, nous mettons notre propre identité à l’épreuve de l’existence de l’autre et non en le mettant de côté.
Les personnages de mes romans expriment parfois un « je » coincé et étriqué par leur perception des autres comme différents ou ennemis, mais cette représentation a été construite par l’histoire et l’idéologie. Elle ne constitue pas un point de départ ou un objectif de mes récits. Dans Le beau Juif, les juifs et les musulmans partagent un même extrémisme religieux, mais aussi un désir de coexistence. Ce que dit la femme algérienne dans L’encens d’Aden sur la nécessité de libérer la « patrie sacrée » de l’occupation française se retrouve dans ce que ressent le jeune Français quant à la libération de la France du joug nazi. L’affirmation de l’homme de religion sur l’exigence de suivre les préceptes de l’islam s’accorde avec la nécessité exprimée par les révolutionnaires d’œuvrer à la réalisation des objectifs de la révolution. L’extrémiste de gauche (« progressiste ») dans Femme interdite se transforme en extrémiste religieux (« passéiste »).
Vous traitez souvent le thème du pouvoir religieux de manière critique. Comment peut-on s’en défaire pour assumer ses choix, notamment pour les croyants ?
En monopolisant l’interprétation du monde et de la vie, le pouvoir religieux nuit à la société et empêche son développement ; il entrave aussi l’ouverture de la religion elle-même vers d’autres potentiels et orientations majeures de l’être humain. Il n’est pas nécessaire de chercher une alternative à la religion, mais il est important de laisser prospérer les formes de pensée et de connaissance. La religion ne vit pas en vase clos, et chaque religion est plurielle, composée de différents courants. Tout le monde peut ainsi vivre sans être tenté d’exclure et d’éliminer l’Autre.
Comment percevez-vous les relations du monde arabe à la modernité contemporaine et ses conséquences sur la littérature ?
Les projets politiques arabes antérieurs, qu’ils relèvent du nationalisme, du marxisme ou l’islam, ont échoué à répondre aux exigences de la modernisation sociale. Chacun d’entre eux s’est érigé en alternative à l’Autre, ce qui a entravé la mise en place d’une démocratie pluraliste. Les bouleversements en cours dans le monde arabe semblent avoir balayé tous ces projets unidimensionnels, et ont conduit, dans certains cas, à des régressions avec le retour de dictatures. Dans ce contexte, la littérature reste une question individuelle liée au pouvoir de l’auteur à dépasser les conditions misérables qui l’entourent et à réaliser ses propres projets littéraires.
Est-ce que le fait d’avoir été traduit en plusieurs langues étrangères ne vous inspire pas une certaine inquiétude quant au devenir de vos textes ?
Il est vrai que la traduction suscite une certaine angoisse pour un écrivain soucieux du choix des mots et de construction de la syntaxe, et qui expérimente différentes formes narratives avant de trouver celle qui s’accorde le mieux avec ses exigences artistiques. En outre, certaines maisons d’édition ont leurs propres critères d’évaluation de la manière dont on doit écrire un roman. Il est parfois difficile, pour un auteur, de défendre son droit à créer son propre monde narratif et de convaincre que l’on peut aussi écrire un roman de cette manière. Par exemple, Le beau Juif a été inspiré par l’écriture de chroniques arabes, sans les copier. De fait, j’ai intentionnellement laissé les détails dans l’obscurité et j’ai centré la construction du livre sur un seul fil narratif. Dans Saveur noire, odeur noire, les personnages apparaissent et disparaissent soudainement, dans un récit qui n’est ni hiérarchisé ni détaillé, et cela pour rendre au mieux leur manière de vivre instable. Il est certain que cette façon d’écrire ne correspond pas aux conceptions communes et consacrées de la mise en récit.
Entretien réalisé et traduit de l’arabe par Franck Mermier (janvier 2020).
Note
(1) Sur les quelque 30,5 millions d’habitants que compte le Yémen en 2019, 99 % sont musulmans. Les juifs sont une minorité religieuse historique du pays, où ils sont présents depuis la fin du IVe siècle à la suite de la conversion du roi Abikarib Assad. Il resterait de nos jours quelques dizaines de Yéménites de confession juive, résidant pour la plupart à Sanaa, la capitale. Quant aux akhdam, ils sont surtout originaires de zones rurales du sud et de l’ouest du Yémen. Ils souffrent d’ostracisme social, et leurs représentants tentent d’imposer le terme muhammachoun (« marginalisés »), akhdam voulant dire « serviteurs ». Il n’existe aucune donnée sur leur nombre.
Ali al-Muqri
Écrivain yéménite, auteur de nombreux ouvrages (poésie, romans, essais), dont, en français, Le beau Juif (2011), Femme interdite (2015) et Le pays du Commandeur (2020), parus aux Éditions Liana Lévi. Né à Taez en 1966, il a fui la guerre et réside en France depuis 2015
Légende de la photo en première page : Contrairement aux attentes de la révolution, la presse yéménite ne s’est pas libérée après 2011. © Shutterstock/ymphotos
Retrouver l’article original sur le site 



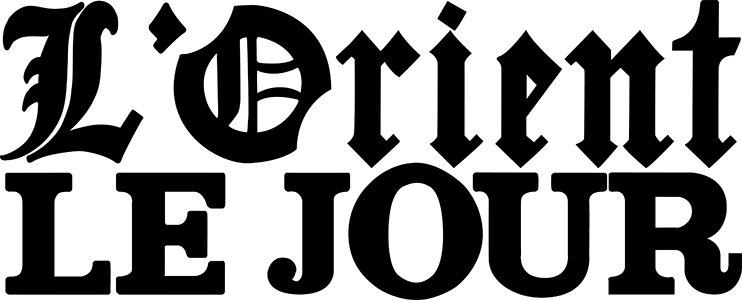
Vous devez être connecté pour poster un commentaire.